Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains
Frères,
devant la promesse de Dieu, Abraham n’hésita pas,
il ne manqua pas de foi,
mais il trouva sa force dans la foi
et rendit gloire à Dieu,
car il était pleinement convaincu
que Dieu a la puissance d’accomplir ce qu’il a promis.
Et voilà pourquoi
il lui fut accordé d’être juste.
En disant que cela lui fut accordé,
l’Écriture ne s’intéresse pas seulement à lui,
mais aussi à nous,
car cela nous sera accordé puisque nous croyons
en Celui qui a ressuscité d’entre les morts Jésus notre Seigneur,
livré pour nos fautes
et ressuscité pour notre justification.
– Parole du Seigneur.
Croire à la promesse : quand la foi devient justice
Comment la conviction d’Abraham éclaire notre propre rapport à la promesse et à la confiance en Dieu
Cette méditation sur Rm 4, 20–25 propose un chemin de lecture vivant et argumenté de la foi d’Abraham, modèle d’une confiance qui justifie parce qu’elle s’enracine dans la promesse même de Dieu. Paul y déploie une théologie de la foi transcendante mais incarnée : croire, c’est déjà répondre à l’appel du Dieu qui accomplit. Dans un monde où la défiance l’emporte souvent, cette lettre résonne comme un appel apaisé à réapprendre la confiance. L’article s’adresse à celles et ceux qui cherchent à conjuguer foi, intelligence et vie quotidienne, dans la lumière d’une justice reçue comme don.
- Contexte : la foi d’Abraham et la généalogie spirituelle de Paul.
- Analyse centrale : une foi qui justifie parce qu’elle espère.
- Axes de déploiement : la promesse, la puissance, la fidélité.
- Résonances traditionnelles : de la foi d’Israël à celle de l’Église.
- Pistes pratiques : comment vivre « cela sera accordé » aujourd’hui.

Contexte
La Lettre aux Romains est sans doute le texte le plus dense et théologiquement structuré de saint Paul. Rédigée vers 57-58, alors qu’il s’apprête à se rendre à Jérusalem puis à Rome, elle expose la grande architecture de la justification par la foi. Paul s’adresse à une communauté qu’il ne connaît pas encore personnellement et cherche à unir juifs et païens dans une même compréhension du salut. C’est dans ce cadre que prend place le passage du chapitre 4, où Paul évoque Abraham comme figure fondatrice de la foi.
Abraham devient l’exemple par excellence de celui qui a cru sans preuve, sans appui autre que la parole divine. Dieu lui a promis une descendance alors que lui-même et Sara étaient avancés en âge. Cette situation d’impossibilité met en relief le cœur du message paulinien : la foi ne naît pas de la maîtrise humaine mais de la confiance en un Dieu capable « d’accomplir ce qu’il a promis ».
Paul écrit : « Cela lui fut accordé d’être juste. » Or, ajoute-t-il, « l’Écriture ne s’intéresse pas seulement à lui » : cette déclaration a valeur universelle. Abraham n’est pas une icône isolée, mais la première pierre d’un édifice spirituel qui préfigure la justification offerte à tous par la résurrection du Christ.
Dans cette perspective, l’expression « cela nous sera accordé puisque nous croyons » devient un pivot théologique. Comme Abraham reçut justice par la foi, le croyant d’aujourd’hui reçoit justification par celle qu’il met dans le Christ ressuscité. La promesse faite à Abraham trouve son accomplissement christique : le passage du particulier à l’universel, du charnel (descendance biologique) au spirituel (descendance dans la foi).
Ce texte, donc, relie de manière subtile trois niveaux :
- le passé biblique : la foi d’Abraham comme modèle d’espérance,
- le présent paulinien : la foi comme principe de justification,
- le présent du lecteur : la foi comme réponse active à une promesse toujours actuelle.
Cet entrelacement permet à Paul de proposer une anthropologie spirituelle : nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons, mais par la confiance vivante placée en Dieu. En d’autres termes, la foi n’est pas simple assentiment intellectuel mais acte de reconnaissance — un abandon qui se traduit ensuite en conduite juste.
Dans la culture gréco-romaine façonnée par la logique des mérites, cette idée de justification gratuite et universelle renversait les représentations religieuses habituelles. Paul inaugurait une nouvelle compréhension du rapport entre l’homme et Dieu : non plus une ascension morale vers le divin, mais une alliance dans laquelle Dieu, le premier, rend juste celui qui accueille sa promesse.

Une foi qui justifie parce qu’elle espère
Au cœur de Rm 4, Paul met en scène un mouvement double : de Dieu vers l’homme (la promesse) et de l’homme vers Dieu (la foi). Cette dynamique de réciprocité repose sur la conviction qu’il existe chez Dieu une fidélité absolue. Abraham devient le témoin d’une foi « contre toute espérance » : croire que quelque chose adviendra alors que tout semble indiquer le contraire.
Ce geste intérieur est performatif. Il crée la justice, non parce qu’il la produit moralement, mais parce qu’il s’ajuste à la vérité divine — à la promesse tenue. C’est le sens même du mot justice dans la Bible : être ajusté, accordé à la volonté et à la fidélité de Dieu.
Chez Paul, la justification par la foi ne signifie donc pas une abstraction juridique, mais un acte relationnel : devenir juste, c’est s’accorder au rythme de Dieu. Et cet accord se manifeste dans l’histoire. Abraham a cru avant même de recevoir le signe de l’alliance (la circoncision), anticipant ainsi la foi chrétienne qui précède les œuvres.
Dans la seconde partie du passage, Paul fait un saut herméneutique décisif : « En disant que cela lui fut accordé, l’Écriture ne s’intéresse pas seulement à lui, mais aussi à nous. » Par ce déplacement, il universalise la promesse : les croyants, quelles que soient leurs origines, participent de la même foi qu’Abraham.
Cette participation se réalise pleinement dans le Christ. La foi du patriarche annonçait déjà celle des disciples qui croiront en « celui qui a ressuscité d’entre les morts Jésus notre Seigneur ». Le lien entre la mort et la résurrection du Christ structure la nouvelle compréhension de la foi : croire, c’est reconnaître que la vie jaillit de la mort, que la promesse se vérifie dans l’impossible accompli.
En conséquence, « cela nous sera accordé » devient la formule condensée de toute la théologie paulinienne. L’acte de foi relie l’homme au Dieu vivant, non par mérite, mais par consentement. Cela « sera accordé » parce que Dieu lui-même promet et accomplit. Ainsi, la justice n’est plus un état à conquérir mais une réalité à recevoir.

La promesse : un horizon ouvert
La promesse divine à Abraham — une descendance nombreuse — ne se comprend que comme une ouverture. Le futur s’y déploie comme espace de confiance. La foi du croyant reçoit cette promesse comme un horizon, non une possession. En affirmant que la justice « sera accordée », Paul inscrit la foi dans le temps de l’attente active.
Dans l’expérience humaine, chaque promesse suppose un risque : celui d’être déçu. Paul renverse cette structure existentielle : la promesse de Dieu ne trahit jamais, mais se réalise souvent autrement que prévu. C’est pourquoi la foi d’Abraham devient paradigmatique : elle repose non sur la prévision de l’accomplissement, mais sur la certitude du Promettant.
Ainsi, croire n’est pas seulement espérer que quelque chose adviendra ; c’est déjà entrer dans l’accomplissement en se fiant à celui qui parle. La promesse devient alors dynamisme intérieur, moteur spirituel. Elle sauve de la résignation.
La puissance de Dieu : accomplir l’impossible
Paul insiste : Abraham fut « pleinement convaincu que Dieu a la puissance d’accomplir ». La foi ne se fonde pas sur l’évaluation humaine des possibles, mais sur la reconnaissance d’une puissance créatrice. Dans la Bible, puissance ne signifie pas coercition, mais capacité à faire advenir la vie. Dieu « accomplit » parce qu’il crée.
Cette conviction libère Abraham de l’angoisse du contrôle. Elle lui permet d’espérer sans preuve. Là se joue une dimension essentielle de la foi : l’abandon actif. Elle n’est ni passivité ni naïveté, mais adhésion confiante à une force qui dépasse le calcul humain.
Ce même acte est appelé chez Paul pistis : une fidélité mutuelle entre Dieu et l’homme. L’énergie de la foi ne vient pas du sujet croyant, mais du lien entre la promesse et son auteur. Ainsi, « ce qu’il promet, il l’accomplit » devient non un slogan moral, mais une description du réel tel que Dieu le façonne.
La fidélité : foi et justification
Dans la logique paulinienne, être justifié signifie être mis en juste relation. Abraham n’est pas déclaré juste parce qu’il accomplit des œuvres exemplaires, mais parce que sa confiance ouvre son cœur à la fidélité divine. La justice devient réponse. En croyant, l’homme laisse Dieu être Dieu.
Le lien entre foi et fidélité est indissociable : croire, c’est accueillir la fidélité du Dieu qui croit en l’homme. Cette circularité fonde la justification. Dans la résurrection du Christ, elle atteint sa plénitude : en ressuscitant Jésus, Dieu authentifie non seulement son Messie, mais aussi la promesse faite à Abraham. Désormais, la foi humaine s’adosse à un événement scellé dans l’histoire.
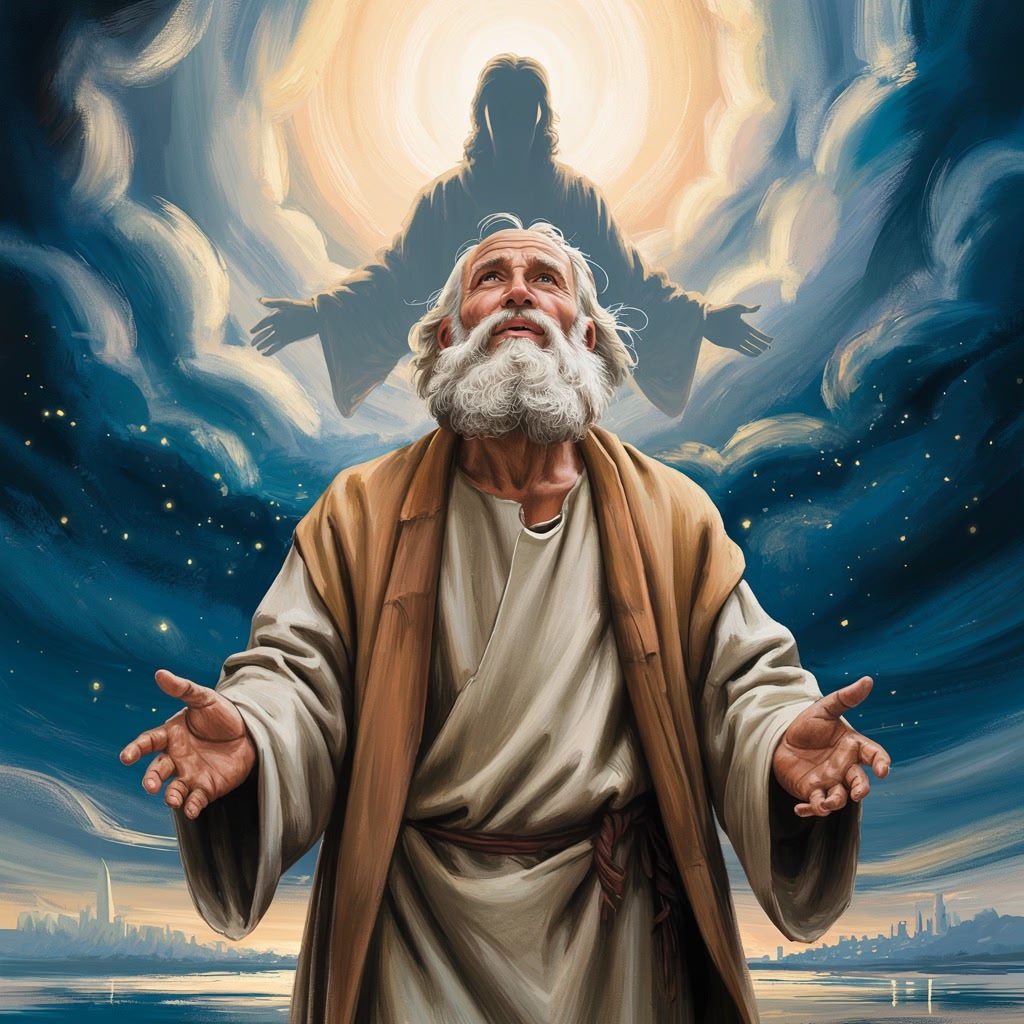
Résonances
L’interprétation de Paul prolonge celle déjà amorcée dans la tradition juive. Dans Genèse 15, Abraham est déclaré juste avant d’avoir vu la promesse s’accomplir. Les Pères de l’Église, notamment Irénée et Augustin, liront ce passage comme le fondement de la théologie de la grâce. Pour Augustin, la foi d’Abraham annonce la justification « sans les œuvres de la Loi », car Dieu « rend juste le pécheur » par amour.
Au Moyen Âge, Thomas d’Aquin reprendra le même thème dans la Somme théologique : la justice n’est pas le fruit de nos actes mais de la participation à la vérité divine. Luther, plus tard, redécouvrira cette affirmation paulinienne et en fera le socle de la Réforme. Ainsi, de siècle en siècle, le texte nourrit diverses compréhensions de la foi agissante.
Dans la spiritualité contemporaine, cette promesse « cela sera accordé » s’entend aussi comme un appel concret : Dieu continue d’écrire avec nous des promesses de libération. Croire devient alors un acte de résistance à la peur et au cynisme.
Méditations
- Relire la promesse personnelle : Quelles paroles de foi m’ont été données ? Les noter et les confier à la prière.
- Nommer les impossibles : Identifier les domaines où je ne crois plus à la possibilité de Dieu d’agir.
- Pratiquer la gratitude : Chaque soir, dire merci pour une promesse déjà tenue.
- Chercher l’ajustement : Dans un conflit, un choix, me demander : quelle est la fidélité à laquelle Dieu m’appelle ici ?
- Espérer pour autrui : Intercéder pour ceux qui doutent, comme Abraham pour sa descendance.
La foi comme espace commun
En refermant cette lecture, nous pouvons entendre la confidence de Paul non comme un traité théologique, mais comme une invitation personnelle. Abraham crut, et cette foi traversa les âges jusqu’à nous. Croire aujourd’hui, c’est inscrire son existence dans une lignée d’espérance.
Lorsque tout en nous réclame la garantie du visible, la foi offre un autre appui : la promesse d’un Dieu qui accomplit. Cette promesse invite à la disponibilité, à la patience, à l’émerveillement. Elle fait de la vie croyante une aventure partagée : non la possession de la vérité, mais la marche avec Celui qui tient parole.
Ainsi, « cela nous sera accordé » devient plus qu’une affirmation dogmatique : une respiration du cœur croyant. C’est le langage de la confiance offerte, la grammaire de la joie, la certitude que la justice n’est pas un dû, mais un don.
Pratique
- Méditer chaque matin une phrase de promesse biblique.
- Écrire les signes de fidélité vécus dans la semaine.
- Remplacer une plainte par une parole de confiance.
- Lire Genèse 15 et Rm 4 en parallèle.
- Prier pour croire « contre toute espérance ».
- Confier sa journée : « Dieu, tu accomplis ce que tu promets. »
- Transmettre la paix reçue à une personne en doute.
Références
- La Bible de Jérusalem, Épître aux Romains.
- Augustin, De la foi et des œuvres.
- Thomas d’Aquin, Somme théologique, II-II.
- Luther, Commentaire de l’Épître aux Romains.
- J. Guitton, La foi et la raison.
- Benoît XVI, Spe Salvi.
- N. Lohfink, Théologie de la promesse dans l’Ancien Testament.



