Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là,
de grandes foules faisaient route avec Jésus ;
il se retourna et leur dit :
« Si quelqu’un vient à moi
sans me préférer à son père, sa mère, sa femme,
ses enfants, ses frères et sœurs,
et même à sa propre vie,
il ne peut pas être mon disciple.
Celui qui ne porte pas sa croix
pour marcher à ma suite
ne peut pas être mon disciple.
Quel est celui d’entre vous
qui, voulant bâtir une tour,
ne commence par s’asseoir
pour calculer la dépense
et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ?
Car, si jamais il pose les fondations
et n’est pas capable d’achever,
tous ceux qui le verront vont se moquer de lui :
“Voilà un homme qui a commencé à bâtir
et n’a pas été capable d’achever !”
Et quel est le roi
qui, partant en guerre contre un autre roi,
ne commence par s’asseoir
pour voir s’il peut, avec dix mille hommes,
affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ?
S’il ne le peut pas,
il envoie, pendant que l’autre est encore loin,
une délégation pour demander les conditions de paix.
Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas
à tout ce qui lui appartient
ne peut pas être mon disciple. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
Renoncer pour suivre : bâtir sa vie sur la dépossession évangélique
Pourquoi l’exigence de Jésus sur le détachement intérieur ouvre un chemin de liberté vraie et de fécondité intérieure.
Cette lecture de l’Évangile de Luc (14, 25‑33) s’adresse à ceux qui cherchent la cohérence entre foi et vie quotidienne, entre la radicalité des paroles de Jésus et la tendresse de son appel. Être disciple du Christ, c’est consentir à un renversement intérieur : ne rien préférer à Lui, jusqu’à réévaluer nos liens, nos biens, nos projets. Cette exigence, loin d’être un refus du monde, révèle une dynamique d’amour libérée de la possession. Cet article propose une démarche progressive pour comprendre, accueillir et vivre ce renoncement comme une source de joie.
- Contexte évangélique et portée du passage
- Analyse de la triple exigence du disciple
- Trois axes pour comprendre le renoncement évangélique
- Applications concrètes dans la vie ordinaire
- Résonances scripturaires et spirituelles
- Pistes de méditation et de mise en pratique
- Défis contemporains et conversion du regard
- Prière de confiance et d’abandon
- Conclusion et engagements simples à poser
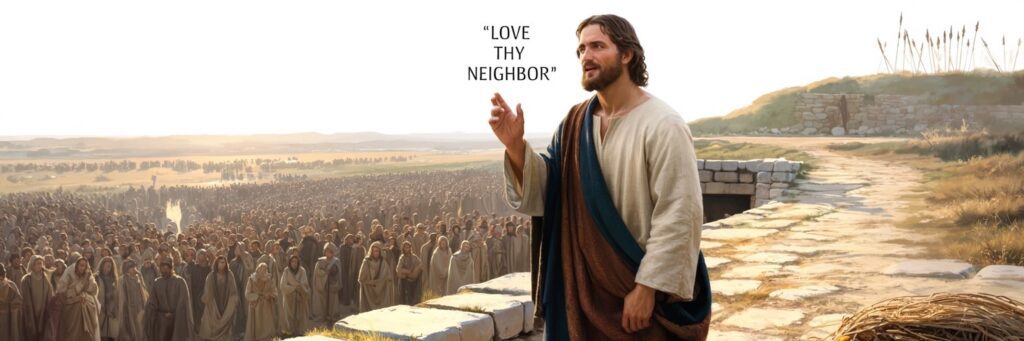
Le choc du renoncement : replacer la parole dans son contexte
L’évangile de Luc présente souvent Jésus en marche. Le cadre du chapitre 14 est significatif : des foules suivent Jésus, fascinées par sa parole et ses signes. Or, loin d’encourager un enthousiasme superficiel, il les confronte à la vérité du chemin. Être disciple ne consiste pas à l’admirer, mais à le suivre jusqu’au bout. Le ton est abrupt : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère… il ne peut être mon disciple. » Ce langage déroute, surtout dans une culture attachée à la famille, aux liens du sang, aux sécurités matérielles.
Cette inversion logique révèle l’enjeu immense : Jésus ne veut pas d’adhésions fragiles mais de cœurs libres. La double parabole qui suit — celle du bâtisseur et celle du roi — montre l’importance de discerner avant de s’engager. Être chrétien n’est pas une émotion, mais une construction qui demande des fondations solides. Le disciple est celui qui « calcule la dépense », non pas par frilosité, mais par lucidité aimante : il comprend que suivre le Christ suppose tout donner.
Dans la culture biblique, renoncer n’équivaut pas à mépriser. Il s’agit plutôt d’ordonner : placer chaque attachement à sa juste place. La radicalité évangélique ne détruit pas l’amour humain ; elle l’illumine. Le Christ ne demande pas d’abandonner nos proches, mais de ne plus les posséder. Il ne réclame pas de mépriser nos biens, mais d’en devenir maîtres pour les mettre au service.
Luc s’adresse à une communauté déjà confrontée aux tensions du choix : comment rester fidèles face à la famille juive qui rejette la foi nouvelle, face aux contraintes économiques et sociales de l’Empire ? Ce passage invite donc à redéfinir la fidélité comme un déplacement du centre de gravité : non plus soi, mais le Christ.
Être disciple en vérité : comprendre les images de Jésus
Jésus emploie deux images quotidiennes — bâtir une tour et partir en guerre — pour illustrer la cohérence entre intention et durée. Le bâtisseur imprudent symbolise le croyant enthousiaste mais sans persévérance ; il pose un fondement sans prévoir le coût. Le roi mal préparé évoque celui qui part dans la vie spirituelle sans reconnaître ses forces réelles. Ces paraboles dénoncent l’illusion d’une foi superficielle.
Mais ce passage va plus loin : il unit discernement et renoncement. La vraie pauvreté n’est pas subie, elle est choisie. Jésus demande de « porter sa croix », expression typique de Luc, évoquant la fidélité jusque dans la souffrance. La croix ici n’est pas seulement un instrument de mort, mais une manière de vivre : accepter de perdre pour aimer davantage.
Pour comprendre cette sobriété radicale, il faut la relier à l’enseignement de la Sagesse. Renoncer, dans la Bible, c’est faire un exode intérieur : quitter les illusions pour entrer dans la vérité. Comme Abraham quittant sa terre, le disciple quitte les sécurités de possession, de reconnaissance, de maîtrise. Le Christ appelle à une relation vivifiante où la dépendance devient liberté, car elle se fonde non sur la peur, mais sur la confiance.
Le passage culmine avec cette phrase lapidaire : « Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » Cette formule absolue n’exclut pas, elle oriente. Elle redéfinit la propriété : ce qui est à moi m’est donné pour servir. Le vrai détachement est intérieur : il libère l’amour de toute emprise.
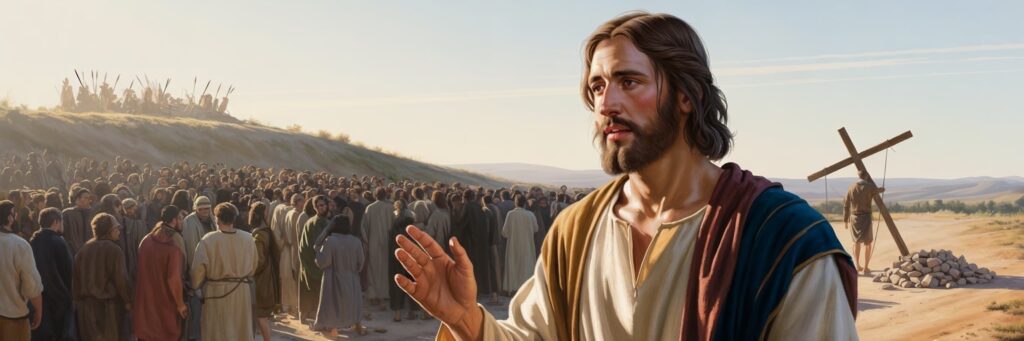
Le renoncement, école de liberté
Renoncer, c’est se délier. Dans une société obsédée par la possession — de biens, d’images, de statuts — l’Évangile propose un autre mode d’existence : recevoir plutôt que posséder, partager plutôt qu’accumuler. Ce détachement ne détruit pas la personnalité ; il révèle l’essentiel.
La liberté chrétienne ne consiste pas à pouvoir tout faire, mais à ne plus être esclave de rien. En renonçant, le disciple goûte à la légèreté du cœur. Le monde promet la sécurité par la maîtrise ; Jésus offre la paix par la confiance. Or, la confiance demande le lâcher-prise. La marche du disciple devient ainsi une école de dépouillement progressif : abandonner les fausses sécurités pour s’enraciner dans la fidélité du Christ.
Le discernement, architecture du renoncement
Jésus n’encourage pas l’improvisation spirituelle. « S’asseoir pour calculer la dépense » décrit la sagesse du cœur. Cela suppose de reconnaître ses limites, de ne pas s’engager à la légère. Le discernement n’est pas un frein mais la condition de la fidélité.
Dans la vie spirituelle, beaucoup commencent sans s’ancrer. On veut aimer Dieu sans se connaître soi-même. Or, discerner, c’est reconnaître ce qui en nous résiste à l’esprit du Christ : l’orgueil, l’attachement, la peur. Le calcul évangélique n’est pas une opération comptable mais un examen intérieur : suis-je prêt à laisser Dieu reconstruire mes fondations ? Là se joue la vraie conversion.
L’amour préférentiel, fondement du détachement
« Préférer » le Christ à tout signifie replacer l’amour dans l’ordre juste. Celui qui aime Dieu en premier apprend à aimer les siens plus profondément. Le détachement évangélique n’est pas une séparation, mais une hiérarchisation.
Dans cette lumière, tout engagement humain devient sanctifié : la famille, le travail, la création, les biens matériels. En les recevant comme des dons et non comme des droits, on découvre la gratitude. C’est cette gratitude qui rend la pauvreté joyeuse : elle n’est pas manque mais offrande.

Incarner le renoncement au quotidien
Vivre ce passage aujourd’hui, c’est déplacer notre logique intérieure. Dans la sphère personnelle, le disciple est invité à purifier ses désirs : apprendre à dire non à la dispersion pour dire oui à la profondeur. Dans la sphère relationnelle, c’est aimer librement, sans chercher à dominer ni à être indispensable. Dans la sphère professionnelle, cela s’exprime par la sobriété des ambitions, la priorité donnée à la justice sur la réussite.
Sur le plan communautaire, cela peut mener à des choix concrets : préférer le bien commun à la reconnaissance personnelle, vivre la simplicité volontaire, soutenir ceux qui manquent de ressources. Dans la sphère ecclésiale, cela appelle à suivre non les préférences mais la mission. Enfin, sur le plan intérieur, renoncer signifie consentir à la faiblesse, confier à Dieu ce qui nous échappe.
Chaque renoncement devient alors un acte de foi. On ne perd pas, on libère l’espace où Dieu peut agir.
Les résonances spirituelles et théologiques du renoncement
Cette parole de Luc s’enracine dans toute la tradition biblique du détachement. Dans la Genèse, Abraham quitte son pays ; dans les Psaumes, le juste met sa confiance non dans les richesses ; dans les Évangiles, les apôtres laissent filets et barques.
La théologie du renoncement s’articule autour du mystère pascal : mourir à soi pour vivre en Dieu. Saint Paul l’exprime : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. » Le renoncement n’est donc pas une humiliation, mais une transformation ontologique.
Dans la tradition monastique, cette attitude devient voie de liberté : saint Benoît parle de « quitter tout pour gagner tout ». Ignace de Loyola formule le détachement comme « indifférence sainte », c’est-à-dire disponibilité intérieure totale.
Sur le plan spirituel, le renoncement ouvre à la grâce de la pauvreté intérieure : quand l’âme cesse de vouloir posséder, elle peut enfin recevoir. Cette disposition fonde la vie contemplative autant que la mission active.
Méditation : marcher à sa suite
Étape 1. Relire le passage lentement, en accueillant la parole sans la juger.
Étape 2. Identifier ce qui, aujourd’hui, occupe le centre de votre cœur : lien, peur, possession.
Étape 3. Demander la grâce de préférer le Christ, non par héroïsme, mais par amour.
Étape 4. Poser un acte concret : partager, pardonner, simplifier.
Étape 5. Chaque soir, confier à Dieu ce que vous ne pouvez porter seul.
La méditation devient ainsi un lieu d’unification intérieure où l’exigence du Christ se transforme en douceur reçue.
Défis actuels : renoncer dans un monde saturé
Nos sociétés valorisent l’autonomie et la performance. Parler de renoncement semble anachronique. Pourtant, les excès du consumérisme montrent notre besoin urgent de redéfinir la liberté.
Le premier défi est psychologique : la peur de manquer. Renoncer heurte notre instinct de sécurité. Mais la réponse évangélique n’est pas la culpabilité : c’est la confiance. Le second défi est social : la réussite matérielle tente même les croyants. La sobriété devient contre-culturelle. Enfin, le défi spirituel est l’individualisme : l’idée qu’on peut suivre le Christ sans communauté.
Face à cela, l’attitude chrétienne consiste à conjuguer discernement et courage : discerner les attachements qui nous enferment, oser s’en libérer peu à peu. Le renoncement évangélique n’est pas spectaculaire : il se vit dans la discrétion du cœur.
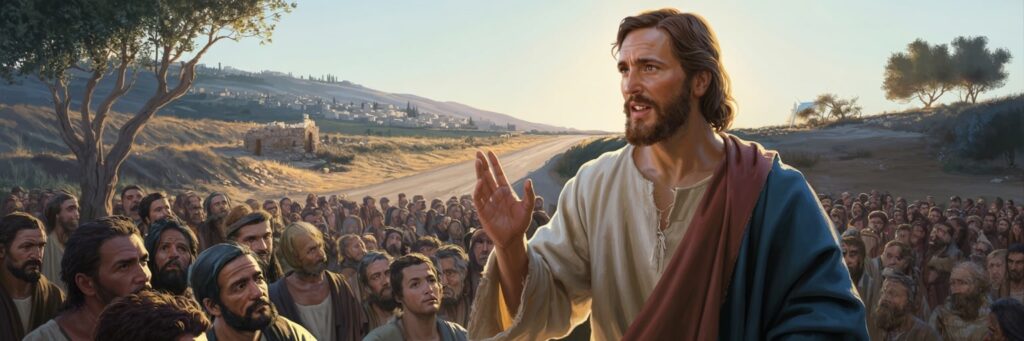
Prière d’abandon et de paix
Seigneur Jésus,
Toi qui as marché sans détour vers la croix,
apprends-moi à marcher dans ton pas.
Apprends-moi à préférer ton amour à mes sécurités,
à poser mes biens entre tes mains.
Quand la peur me retient, rappelle-moi ta parole :
celui qui perd sa vie à cause de toi la sauvera.
Délie mes liens d’orgueil et de possession,
donne-moi la paix du cœur libre.
Que ma vie devienne action de grâce,
ma pauvreté un espace pour ta grâce,
et mes renoncements un chant de confiance.
Que je te suive, non par contrainte,
mais par amour reconnaissant, jusqu’à la joie sans fin.
Conclusion : redécouvrir la joie du dépouillement
Le renoncement chrétien n’est pas une mutilation, mais une ouverture. Loin d’appauvrir, il enrichit. Il libère l’homme des illusions pour le configurer au Christ. Dans un monde qui promet sans cesse le « toujours plus », l’Évangile propose le « mieux vaut peu avec amour ».
Être disciple, c’est apprendre à bâtir sans posséder, à aimer sans retenir. Là se trouve la vraie paix : celle de la confiance en Dieu
Pratiques
- Commencer chaque journée par une offrande simple : « Seigneur, quoi qu’il arrive, je t’appartiens. »
- Choisir une simplicité concrète : renoncer à un achat inutile, à une parole de contrôle, à une plainte.
- Offrir une possession symbolique (objet, habitude, temps) à une œuvre ou à un proche.
- Pratiquer le discernement hebdomadaire : qu’est-ce qui m’attache ? qu’est-ce qui me rend libre ?
- Lire un passage des Psaumes sur la confiance et le méditer avant de dormir.
- Remercier chaque jour pour ce qui est donné, sans comparer.
- Participer à une initiative de solidarité ou de partage.
Références
- Évangile selon saint Luc 14, 25‑33
- Première lettre de Pierre 4, 14
- Règle de saint Benoît, ch. 4
- Ignace de Loyola, Exercices spirituels, n°23
- Thérèse de Lisieux, Derniers entretiens
- Benoît XVI, Jésus de Nazareth, tome I
- François, Exhortation Evangelii Gaudium
- Catéchisme de l’Église catholique, §2544‑2547


