Lecture du livre du Deutéronome
Moïse disait au peuple :
« Tu craindras le Seigneur ton Dieu.
Tous les jours de ta vie,
toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils,
tu observeras tous ses décrets et ses commandements,
que je te prescris aujourd’hui,
et tu auras longue vie.
Israël, tu écouteras,
tu veilleras à mettre en pratique
ce qui t’apportera bonheur et fécondité,
dans un pays ruisselant de lait et de miel,
comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères.
Écoute, Israël :
le Seigneur notre Dieu est l’Unique.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta force.
Ces paroles que je te donne aujourd’hui
resteront dans ton cœur. »
– Parole du Seigneur.
Écoute, Israël : l’appel radical à un amour total envers Dieu
Le Shema révèle comment transformer toute notre existence en réponse d’amour au Dieu unique qui nous a choisis.
Dans le tumulte de notre époque fragmentée, où l’attention se disperse et les loyautés s’émiettent, résonne une parole vieille de trois millénaires qui n’a rien perdu de sa puissance bouleversante. « Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Ces mots du Deutéronome, que Jésus désignera comme le plus grand des commandements, tracent un chemin d’engagement total qui défie nos tiédeurs et nos compromis. Ils s’adressent aujourd’hui à tout chercheur de Dieu, à tout croyant aspirant à l’authenticité, à toute personne qui pressent que l’existence humaine ne peut trouver son sens que dans une relation d’amour absolue avec son Créateur.
Nous explorerons d’abord le contexte historique et spirituel du Shema, cette profession de foi au cœur du judaïsme. Nous analyserons ensuite la structure et la signification profonde de ce commandement d’amour total. Puis nous déploierons ses implications concrètes dans trois dimensions : l’unicité de Dieu face au polythéisme moderne, l’intégralité de notre réponse humaine, et la transmission de cette foi vivante. Enfin, nous découvrirons comment ce texte irrigue la tradition spirituelle chrétienne et juive, avant de proposer des pistes pratiques pour incarner aujourd’hui cet appel révolutionnaire.

Aux sources du Shema : un testament spirituel au seuil de la Terre promise
Le livre du Deutéronome, cinquième et dernier livre de la Torah, se présente comme le testament spirituel de Moïse adressé au peuple d’Israël au moment décisif de son histoire. Après quarante années d’errance dans le désert, les Hébreux se tiennent aux portes de la Terre promise, sur les plaines de Moab, face au Jourdain. Moïse, leur guide prophétique, sait qu’il ne franchira pas le fleuve avec eux. Il prononce alors une série de discours solennels qui forment l’essentiel du Deutéronome, littéralement la « seconde Loi » ou « répétition de la Loi ».
Le contexte est chargé d’une intensité dramatique. Une génération nouvelle s’apprête à conquérir Canaan, cette terre d’abondance promise à Abraham, Isaac et Jacob. Mais Canaan est aussi une terre peuplée de nations païennes, adoratrices de multiples divinités, pratiquant des rites que la Torah réprouve avec vigueur. Le danger est immense : que le peuple élu, une fois installé dans la prospérité, oublie le Dieu qui l’a libéré d’Égypte et se laisse séduire par les cultes environnants. C’est précisément pour prévenir cette dérive que Moïse prononce son ultime enseignement, dont le Shema constitue le cœur battant.
Le chapitre 6 du Deutéronome s’ouvre sur une exhortation générale à observer les commandements divins. Le verset 4 introduit alors la proclamation centrale, suivie immédiatement du commandement d’amour du verset 5. En hébreu, ces mots résonnent avec une densité intraduisible : « Shema Yisraël, Adonaï Elohenou, Adonaï Echad. » Littéralement : « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est Un. » Puis vient l’impératif : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. »
Le premier mot, « Shema », signifie bien plus qu’une simple invitation à prêter l’oreille. Dans la mentalité hébraïque, écouter implique obéir, mettre en pratique, s’engager existentiellement. C’est un verbe d’action qui réclame une réponse concrète de tout l’être. La tradition juive a d’ailleurs remarqué un détail graphique saisissant dans les manuscrits bibliques : les deux dernières lettres du premier et du dernier mot de ce verset, le ayin de « Shema » et le daleth de « Echad », sont écrites en caractères agrandis. Ensemble, ces lettres forment le mot hébreu « ed », qui signifie « témoin ». Par cette proclamation, Israël devient le témoin de l’unicité divine dans un monde polythéiste.
Ce passage ne se contente pas d’affirmer l’existence de Dieu. Il proclame son unicité absolue, sa singularité radicale. Dans l’Antiquité proche-orientale, où chaque cité honorait ses divinités tutélaires, où les panthéons égyptiens, babyloniens ou cananéens comptaient des dizaines de dieux aux fonctions spécialisées, cette déclaration constituait une révolution théologique sans précédent. Le Dieu d’Israël n’est pas un dieu parmi d’autres, ni même le plus puissant des dieux : il est l’unique réalité divine, le créateur de toutes choses, celui qui n’a ni rival ni partenaire.
Le Shema s’inscrit dans une liturgie et une pratique quotidiennes. Dès l’époque du Second Temple, les Juifs récitaient cette prière matin et soir, conformément aux prescriptions qui suivent immédiatement dans le texte biblique : « Ces paroles que je te donne aujourd’hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras sur le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Ainsi, le Shema n’est pas simplement un credo théorique, mais une parole à vivre, à méditer, à transmettre dans tous les moments de l’existence.
L’architecture d’un commandement : unicité divine et amour intégral
Au centre du Shema se tient une affirmation théologique d’une audace bouleversante, suivie d’un commandement éthique d’une exigence vertigineuse. Analysons la structure profonde de cette parole fondatrice pour en saisir toute la portée existentielle et spirituelle.
L’affirmation « le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est Un » peut se comprendre à plusieurs niveaux. Au premier degré, elle proclame le monothéisme contre toutes les formes de polythéisme. Il n’existe qu’une seule source divine, qu’une seule volonté créatrice et rédemptrice. Cette unicité numérique s’oppose frontalement aux religions environnantes qui fragmentent le divin en multiples puissances souvent contradictoires. Mais l’unicité divine va plus loin encore : elle affirme l’unité interne de Dieu, son indivisibilité, sa cohérence absolue. Le Dieu d’Israël n’est pas sujet aux passions changeantes, aux contradictions, aux conflits internes que les mythologies grecque ou proche-orientale prêtent à leurs divinités.
Cette unicité divine fonde directement la possibilité et l’exigence de l’amour total. Si Dieu était multiple, fragmenté, contradictoire, comment pourrions-nous l’aimer de tout notre être sans nous déchirer nous-mêmes ? C’est précisément parce qu’il est Un que nous pouvons et devons l’aimer dans l’unification de toutes nos facultés. L’amour de Dieu n’est pas une option parmi d’autres, un sentiment pieux facultatif : c’est un commandement, le premier et le plus grand de tous. Cette dimension impérative surprend souvent nos contemporains habitués à penser l’amour comme un élan spontané, une émotion échappant au contrôle de la volonté. Comment peut-on commander d’aimer ?
La réponse tient dans la nature même de l’amour biblique. Le terme hébraïque « ahavah » ne désigne pas d’abord un sentiment, mais une orientation fondamentale de l’existence, un choix délibéré de consacrer sa vie à l’objet aimé. Aimer Dieu, c’est décider de faire de lui le centre absolu de notre existence, la référence ultime de toutes nos décisions, le but vers lequel converge chacune de nos actions. Cet amour se traduit concrètement par l’obéissance aux commandements divins, non par contrainte extérieure, mais comme expression naturelle d’une relation d’alliance.
Le commandement précise ensuite les dimensions de cet amour total : « de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Cette triple formulation n’est pas une redondance stylistique, mais une invitation à engager la totalité de notre être humain dans la relation à Dieu. Le cœur, dans l’anthropologie biblique, désigne le siège des décisions, de la volonté, de l’intelligence. Aimer Dieu de tout son cœur signifie orienter toutes nos décisions selon sa volonté, soumettre notre intelligence à sa révélation, choisir délibérément et constamment de lui obéir. Il s’agit d’un engagement rationnel et volontaire, non d’une émotion passagère.
L’âme, ou « nefesh » en hébreu, représente le principe vital, ce qui fait de nous des êtres vivants. Aimer Dieu de toute son âme implique de trouver en lui la source même de notre vie, de notre respiration, de notre énergie existentielle. C’est reconnaître que nous ne vivons pas par nous-mêmes, mais que notre existence tout entière dépend de celui qui nous a créés et qui nous maintient dans l’être à chaque instant. Certaines interprétations rabbiniques vont jusqu’à suggérer que cette formule nous appelle à être prêts à offrir notre vie même pour Dieu, à l’aimer jusqu’au martyre si nécessaire.
La force, enfin, évoque nos capacités d’action, nos ressources matérielles, notre puissance d’intervention dans le monde. Aimer Dieu de toute sa force signifie mettre tous nos moyens concrets au service de sa gloire et de son règne. Cela inclut nos biens matériels, notre temps, nos talents, notre énergie physique. Aucune dimension de notre existence ne peut rester neutre ou extérieure à cette relation d’amour. L’Évangile selon Marc rapporte que Jésus, interrogé sur le plus grand commandement, cite le Shema en y ajoutant une quatrième dimension : « de toute ta pensée » ou « de toute ton intelligence ». Cette addition souligne que la foi authentique engage aussi notre faculté de réflexion et de compréhension. Croire n’est pas abdiquer sa raison, mais la mettre au service de la connaissance de Dieu.
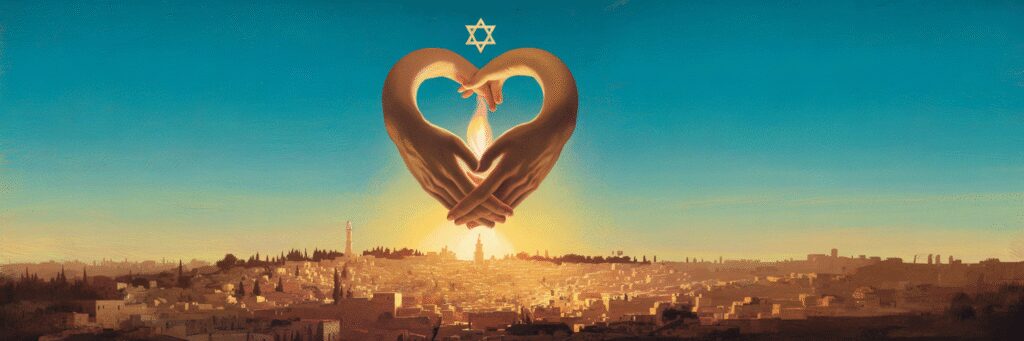
L’unique face aux idoles : le combat permanent du monothéisme
Dans notre monde postmoderne apparemment sécularisé, on pourrait croire que l’affirmation de l’unicité divine a perdu sa pertinence combative. Les statues des dieux antiques ne menacent plus la foi des croyants. Pourtant, le polythéisme n’a jamais vraiment disparu : il s’est simplement métamorphosé, adoptant des formes plus subtiles mais non moins aliénantes.
Le Shema proclame que le Seigneur est Un, ce qui implique radicalement qu’aucune autre réalité ne peut prétendre à l’absolu. Toute absolutisation d’une réalité créée constitue une forme d’idolâtrie. Or, nos sociétés contemporaines excellent dans cette fabrication d’absolus de substitution. L’argent devient une divinité exigeant sacrifices et dévouement total. Le succès professionnel réclame un culte exclusif, dévorant le temps, l’énergie, les relations familiales. La nation peut devenir une idole sanglante à laquelle on offre des vies humaines. La technologie fascine comme une puissance salvatrice promettant de résoudre tous nos problèmes. Même des valeurs authentiques comme la liberté ou l’amour, lorsqu’elles sont absolutisées et coupées de leur source divine, se transforment en idoles tyranniques.
Le monothéisme biblique n’est pas simplement une arithmétique théologique affirmant qu’il existe un Dieu plutôt que plusieurs. C’est une révolution existentielle qui libère l’être humain de tous les asservissements idolâtres. En proclamant que Dieu seul est absolu, le Shema relativise toutes les puissances terrestres, tous les systèmes politiques, toutes les autorités humaines. Rien ni personne en ce monde ne peut exiger un dévouement inconditionnel, car seul Dieu mérite une telle allégeance. Cette affirmation a des conséquences politiques explosives : elle fonde la possibilité de résister aux tyrannies, de désobéir aux ordres injustes, de refuser les compromis avec le mal.
L’histoire du peuple juif témoigne de cette puissance libératrice du monothéisme. Face aux empires qui exigeaient l’adoration de leurs souverains divinisés, les Juifs ont opposé un refus obstiné, préférant parfois la mort à la compromission. Les martyrs maccabéens, torturés pour avoir refusé de transgresser la Loi, ont scellé de leur sang la fidélité au Dieu unique. Cette résistance spirituelle s’est perpétuée à travers les siècles, confrontant tour à tour le pouvoir romain, les régimes chrétiens médiévaux, les totalitarismes modernes. À chaque fois, le Shema récité dans la persécution affirmait qu’aucun pouvoir terrestre ne peut s’arroger le droit d’écraser la conscience humaine en relation avec son Créateur.
Pour le chrétien, l’unicité de Dieu révélée dans le Shema se conjugue mystérieusement avec la révélation trinitaire. Le Père, le Fils et l’Esprit ne sont pas trois dieux, mais trois personnes en une seule essence divine. Le monothéisme chrétien n’est pas aboli par le dogme trinitaire, mais approfondi et enrichi. Jésus lui-même cite le Shema comme le premier des commandements et n’a jamais remis en cause l’unicité fondamentale de Dieu. Cette tension créatrice entre unité et trinité invite à une compréhension toujours plus riche du mystère divin, qui échappe à toute simplification réductrice.
La vigilance monothéiste demeure donc plus nécessaire que jamais. Combien de fois, même parmi les croyants sincères, Dieu se trouve-t-il relégué à une fonction parmi d’autres, honoré le dimanche mais ignoré dans les choix professionnels, financiers, relationnels ? Le Shema nous rappelle brutalement que Dieu est Un et qu’il exige d’être le centre unique de notre existence. Toute fragmentation de notre loyauté, toute division de notre allégeance constitue une forme subtile de polythéisme pratique. La conversion authentique consiste précisément à ramener l’unité dans notre vie en ordonnant toutes choses à l’unique nécessaire : aimer Dieu et lui obéir.
L’intégralité de la réponse humaine : cœur, âme et force en action
Si le Shema proclame d’abord l’unicité de Dieu, il exige ensuite l’unification de notre être tout entier dans la réponse d’amour. Cette exigence d’intégralité défie nos tendances à la fragmentation, à la compartimentation, à la schizophrène division entre foi et vie.
Aimer Dieu de tout son cœur signifie d’abord orienter nos désirs profonds vers lui. Le cœur biblique est le lieu des aspirations, des élans, des attachements fondamentaux. Quelle est la vraie mesure de notre amour de Dieu ? Ce n’est pas l’intensité momentanée de nos émotions religieuses, mais la direction stable de nos désirs les plus profonds. Qu’est-ce qui nous réjouit vraiment ? Qu’est-ce qui nous afflige authentiquement ? De quoi rêvons-nous ? Vers quoi gravitent spontanément nos pensées dans les moments libres ? Aimer Dieu de tout son cœur, c’est réorienter progressivement tous ces mouvements intérieurs vers lui, apprendre à se réjouir de ce qui le réjouit, à s’affliger de ce qui l’offense, à désirer ce qu’il désire pour nous et pour le monde.
Cette réorientation ne se fait pas en un jour. Elle exige une ascèse patiente, un combat spirituel constant contre les attachements désordonnés qui disputent à Dieu la primauté dans notre cœur. Les Pères du désert ont développé toute une sagesse de la purification du cœur, identifiant les passions destructrices qui l’encombrent et proposant des remèdes spirituels. Mais ce travail d’unification intérieure n’est pas d’abord un effort volontariste : il est une réponse à l’amour premier de Dieu qui nous saisit et nous transforme. Plus nous contemplons la bonté divine manifestée en Jésus-Christ, plus notre cœur s’enflamme naturellement d’amour pour lui.
Aimer Dieu de toute son âme engage notre vitalité profonde, notre élan d’exister. Il s’agit de trouver en Dieu la source même de notre joie de vivre, l’origine de notre désir d’être. Trop souvent, nous cherchons cette vitalité dans des substituts épuisants : le divertissement frénétique, la consommation compulsive, les relations passionnelles qui prennent et déçoivent. Le Shema nous rappelle que seul Dieu peut combler la soif existentielle qui nous habite. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant », s’écrie le psalmiste. Cette soif n’est pas un manque négatif, mais l’expression de notre nature même, créée pour la communion avec l’Infini.
Certains commentateurs juifs ont interprété l’expression « de toute ton âme » de manière radicale : aimer Dieu même si cela devait coûter la vie. Le martyre devient ainsi l’expression ultime de cet amour intégral, la démonstration suprême qu’aucun bien terrestre, pas même l’existence biologique, ne peut rivaliser avec l’attachement au Dieu vivant. Peu de croyants sont appelés au martyre sanglant, mais tous sont invités au martyre quotidien : mourir à soi-même, renoncer à ses volontés propres, crucifier l’homme ancien pour laisser place au Christ vivant en nous.
Aimer Dieu de toute sa force engage enfin notre agir concret dans le monde. Cet amour ne peut rester purement intérieur, contemplation détachée des réalités terrestres. Il exige de se traduire en œuvres, en actions concrètes qui manifestent la souveraineté divine sur tous les aspects de notre existence. Notre force physique, notre temps, nos talents, nos ressources financières : tout doit être mobilisé au service du Royaume. Cela ne signifie pas nécessairement quitter le monde pour le cloître, mais transformer toute activité profane en liturgie spirituelle, accomplir les tâches les plus ordinaires dans une intention d’amour et d’offrande.
Saint Paul développera magnifiquement cette spiritualité de l’ordinaire sanctifié : « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Le chrétien authentique ne connaît plus de distinction radicale entre sacré et profane : tout devient occasion de témoigner de son amour de Dieu et de servir ses frères. Le travail professionnel n’est plus simplement un gagne-pain, mais une vocation à participer à l’œuvre créatrice divine. La vie familiale devient un lieu de sanctification mutuelle. Les engagements sociaux et politiques s’enracinent dans l’amour du prochain commandé par Dieu.
Cette intégralité de la réponse humaine suppose une véritable cohérence de vie, une unification de tous les aspects de notre existence sous la seigneurie du Christ. Elle combat l’hypocrisie qui consiste à honorer Dieu des lèvres tandis que le cœur reste loin de lui, à fréquenter les assemblées liturgiques tout en menant une vie contraire aux exigences évangéliques. Le Shema est un appel à la radicalité, non au sens d’un rigorisme légaliste, mais au sens étymologique : aller à la racine, laisser l’amour de Dieu pénétrer jusqu’aux fondements de notre être pour transformer toute notre existence.
La transmission vivante : de génération en génération
Le texte du Deutéronome qui suit immédiatement le Shema insiste avec force sur la nécessité de transmettre ces paroles aux générations futures : « Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras sur le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Cette insistance révèle une dimension essentielle de la foi biblique : elle ne se vit pas dans l’isolement individualiste, mais dans une tradition vivante qui se transmet de parents à enfants, de maîtres à disciples.
La foi en un Dieu unique et l’engagement d’un amour total envers lui ne sont pas des évidences naturelles. Ils doivent être enseignés, expliqués, incarnés, vécus communautairement pour pouvoir être reçus et appropriés par les nouvelles générations. Le judaïsme a développé une pédagogie religieuse remarquable, faisant du foyer familial le lieu premier de l’éducation spirituelle. Le rituel du Seder pascal, par exemple, organise toute la célébration autour des questions que les enfants posent à leurs parents, provoquant ainsi le récit des hauts faits de Dieu dans l’histoire d’Israël. Le Shema doit être récité matin et soir, créant un rythme quotidien qui structure l’existence et grave dans les mémoires ces paroles fondatrices.
Pour le chrétien, cette responsabilité de transmission demeure pleinement actuelle. Dans une société où la foi n’est plus portée par les structures culturelles dominantes, où l’inculture religieuse progresse même parmi les baptisés, l’urgence de transmettre s’impose avec une force nouvelle. Mais comment transmettre efficacement dans un contexte de pluralisme et de sécularisation ? Le Deutéronome nous offre quelques pistes précieuses.
D’abord, la transmission doit être constante et naturelle, intégrée au flux de la vie quotidienne. Non pas seulement lors de cours de catéchisme formels, mais dans les conversations ordinaires, les repas partagés, les promenades, les moments du coucher et du lever. Les enfants apprennent moins par les discours solennels que par l’imprégnation progressive, en observant comment leurs parents prient, comment ils réagissent aux épreuves, comment ils prennent leurs décisions, comment ils parlent de Dieu spontanément. La cohérence entre ce que l’on enseigne et ce que l’on vit constitue la condition sine qua non d’une transmission réussie.
Ensuite, cette transmission doit être dialogique, non autoritaire. Le texte biblique invite à parler, à échanger, à répondre aux questions. Les jeunes générations ont besoin de comprendre, pas seulement d’obéir aveuglément. Elles doivent pouvoir interroger leur foi, exprimer leurs doutes, affronter les objections, pour parvenir à une appropriation personnelle et mature. Une foi imposée sans intelligence est fragile et risque de s’effondrer à la première épreuve. Une foi cherchée, questionnée, approfondie dans le dialogue devient une conviction solide capable de résister aux vents contraires.
La tradition juive a développé le concept de « midrash », cette méthode d’interprétation qui consiste à questionner le texte biblique, à explorer ses ambiguïtés, à proposer des lectures multiples. Loin d’affaiblir la foi, cette approche interrogative la vivifie, montrant que la Parole de Dieu est inépuisable, toujours nouvelle, capable de parler à chaque génération dans son contexte particulier. Les communautés chrétiennes gagneraient à développer des espaces de questionnement ouvert, où les jeunes peuvent exprimer leurs difficultés sans être jugés, où les adultes acceptent de ne pas avoir réponse à tout, où tous ensemble cherchent à mieux comprendre les implications concrètes de la foi.
Enfin, la transmission authentique exige des témoins crédibles. On ne transmet vraiment que ce que l’on vit soi-même avec conviction. Les jeunes générations ont un détecteur infaillible de l’hypocrisie et de la tiédeur. Ils sont prêts à s’engager totalement si on leur propose un idéal exigeant, mais incarné par des adultes qui en paient eux-mêmes le prix. Le Shema appelle à un amour radical de Dieu : nos vies doivent en témoigner concrètement pour que cet appel résonne comme une invitation libératrice et non comme un fardeau insupportable.

Tradition spirituelle
Le Shema a irrigué toute la tradition spirituelle juive et chrétienne, devenant une source inépuisable de méditation, d’interprétation et de pratique. Les Pères de l’Église y ont vu l’expression parfaite du premier et plus grand commandement, fondement de toute la vie morale et spirituelle.
Saint Augustin, dans ses commentaires sur l’Évangile de Jean, développe une théologie de l’amour de Dieu qui s’enracine directement dans le Shema. Pour lui, aimer Dieu de tout son cœur signifie orienter vers lui tout le poids de notre être, faire de lui le centre de gravité de notre existence. Cette centralité de l’amour divin n’exclut pas les autres amours légitimes, mais les ordonne et les purifie. Nous aimons nos proches, nos activités, la création elle-même, mais en référence à Dieu et pour Dieu, évitant ainsi que ces amours créés ne deviennent des absolus idolâtriques.
Thomas d’Aquin, dans la Somme théologique, traite longuement du commandement de l’amour de Dieu. Il souligne que cet amour est à la fois naturel et surnaturel. Naturel, car toute créature tend spontanément vers le bien suprême qui est Dieu, même lorsqu’elle ne le reconnaît pas explicitement. Surnaturel, car l’amour de charité qui nous unit à Dieu dépasse infiniment nos capacités naturelles et n’est possible que par la grâce du Saint-Esprit répandue en nos cœurs. Cette double dimension préserve à la fois la continuité entre nature et grâce, et la gratuité absolue du don divin.
Les mystiques chrétiens ont exploré les hauteurs et les profondeurs de cet amour total de Dieu. Jean de la Croix décrit le chemin de purification qui conduit l’âme à s’unir totalement à Dieu, renonçant à tout attachement désordonné pour parvenir à cette nuit obscure où seul demeure l’amour pur. Thérèse d’Avila raconte les étapes de l’oraison contemplative, où l’âme passe progressivement de l’effort ascétique à l’abandon confiant dans les bras de Dieu. Ces grands témoins spirituels ont vécu concrètement ce que le Shema commande : une relation d’amour absolu avec le Dieu unique qui transforme toute l’existence.
Dans la tradition juive, le Shema occupe une place liturgique centrale. Il est récité deux fois par jour, matin et soir, dans la prière quotidienne. Il est également prononcé au moment de la mort, constituant l’ultime confession de foi du mourant. Les martyrs juifs à travers l’histoire ont scellé leur témoignage en récitant le Shema dans les flammes des bûchers ou face aux pelotons d’exécution. Cette prière est aussi la première que l’on enseigne aux enfants, gravant dès le plus jeune âge dans leur cœur l’unicité de Dieu et l’appel à l’aimer totalement.
Les commentaires rabbiniques ont exploré toutes les nuances de ce texte fondateur. La Mishna et le Talmud discutent des intentions requises pour réciter validement le Shema, du moment précis où il faut le dire, de la posture corporelle appropriée. Ces détails apparemment légalistes expriment en réalité une préoccupation profonde : comment honorer dignement cette parole suprême ? Comment éviter la routine machinale qui viderait de son sens cette proclamation de foi ?
Méditations
Comment incarner aujourd’hui, dans notre vie concrète, l’appel du Shema à un amour total de Dieu ? Voici quelques pistes pratiques, adaptables selon les situations personnelles de chacun.
Commencez par instaurer un double rendez-vous quotidien avec la Parole de Dieu, le matin au réveil et le soir avant de dormir. Ces deux moments encadrent la journée, la plaçant sous le regard de Dieu. Le matin, récitez le Shema comme une offrande de la journée qui commence, un engagement à chercher en toute chose la gloire divine. Le soir, reprenez ces mêmes mots comme une évaluation : comment ai-je aimé Dieu aujourd’hui de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force ? Où ai-je échoué ? Où l’amour de Dieu s’est-il manifesté concrètement dans mes choix et mes actions ?
Pratiquez l’examen particulier en vous concentrant spécifiquement sur l’une des trois dimensions de l’amour de Dieu. Une semaine, examinez vos désirs de cœur : vers quoi gravitent spontanément vos pensées ? Quels attachements désordonnés empêchent votre cœur d’être tout à Dieu ? La semaine suivante, interrogez votre vitalité spirituelle : où puisez-vous vraiment votre joie de vivre ? En Dieu ou dans des substituts décevants ? La troisième semaine, évaluez votre action concrète : comment utilisez-vous vos ressources, votre temps, vos talents ? Sont-ils au service du Royaume ou accaparés par l’égoïsme ?
Mémorisez le Shema en hébreu si possible, ou au moins dans votre langue maternelle. La mémorisation permet de porter constamment en soi cette parole vivante, de la ruminer dans les transports, les files d’attente, les moments d’insomnie. Cette présence intérieure de la Parole transforme progressivement notre manière de percevoir la réalité.
Partagez le Shema en famille ou en communauté. Établissez un rituel simple où chaque membre peut exprimer comment il a expérimenté l’amour de Dieu pendant la semaine écoulée, où il l’a vu à l’œuvre dans sa vie ou autour de lui. Ce partage crée une mémoire commune, tisse des liens spirituels profonds, et éduque chacun à reconnaître la présence divine dans l’ordinaire de l’existence.
Pratiquez le jeûne des idoles modernes. Identifiez dans votre vie les réalités qui tendent à prendre la place de Dieu : le téléphone portable consulté compulsivement, les réseaux sociaux dévorant votre attention, le travail envahissant tout l’espace mental, les séries télévisées consommées sans discernement. Choisissez périodiquement de jeûner de ces réalités pour vérifier qu’elles n’ont pas pris un caractère idolâtre dans votre vie, et pour libérer du temps et de l’espace intérieur pour Dieu.
Enfin, engagez-vous concrètement dans une forme de service où vous mettez votre force au service du Royaume : visite aux malades, engagement caritatif, catéchèse, accompagnement de personnes en difficulté. L’amour de Dieu ne peut rester abstrait : il doit se traduire en amour effectif du prochain, lieu concret où nous rencontrons le Christ lui-même.
Une révolution existentielle pour aujourd’hui
Au terme de ce parcours, le Shema apparaît non comme une relique vénérable d’un passé révolu, mais comme une parole brûlante d’actualité, capable de bouleverser radicalement notre manière de vivre et de croire. Dans une époque caractérisée par la fragmentation identitaire, la multiplication des sollicitations, la dispersion de l’attention et l’effacement de tout absolu, l’appel à aimer le Dieu unique de tout notre être résonne comme une libération.
Cette parole nous libère d’abord de la tyrannie des faux absolus. En proclamant que Dieu seul mérite notre engagement total, le Shema relativise toutes les idoles modernes qui réclament nos sacrifices : l’argent, le succès, la consommation, l’image sociale, le plaisir immédiat. Nous pouvons utiliser ces réalités sans nous y asservir, les apprécier sans les absolutiser, en jouir sans en faire notre raison d’être. Cette liberté intérieure transforme notre rapport au monde, nous permettant d’habiter la modernité sans y perdre notre âme.
Le Shema nous libère ensuite de la schizophrénie existentielle qui sépare artificiellement foi et vie, spiritualité et quotidien, prière et action. En exigeant que nous aimions Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, ce commandement nous appelle à l’unification intérieure, à la cohérence entre ce que nous croyons et ce que nous vivons. Plus de double vie possible, plus de compromis hypocrite : toute notre existence, dans ses dimensions les plus ordinaires comme les plus solennelles, doit devenir le lieu d’un amour de Dieu vécu et incarné.
Cette révolution existentielle commence par une conversion du regard. Apprendre à voir toute réalité en référence à Dieu, à discerner sa présence dans les événements quotidiens, à reconnaître sa providence même dans les épreuves. Les mystiques chrétiens parlaient de la pratique de la présence de Dieu : cet entraînement patient à se rappeler constamment que nous sommes sous le regard aimant du Père, que chaque instant est une occasion de lui plaire, que toute rencontre humaine est une possibilité de le servir.
Elle se poursuit par une transformation du cœur. Nos désirs profonds, façonnés par la culture de consommation et les pressions sociales, doivent être progressivement réorientés vers Dieu. Ce travail de rééducation du désir est long et difficile. Il exige la purification de nos attachements désordonnés, le renoncement aux sécurités trompeuses, l’abandon confiant à la providence divine. Mais cette ascèse libère une joie profonde, celle de désirer enfin ce qui peut vraiment nous combler, d’espérer ce qui ne décevra jamais.
Elle s’accomplit dans l’action concrète. Un amour qui ne se traduit pas en actes est une illusion sentimentale. Aimer Dieu de toute sa force signifie mobiliser toutes nos ressources pour l’avènement de son Royaume. Cela peut prendre mille formes selon les vocations particulières : engagement familial vécu comme un sacerdoce, travail professionnel transfiguré par l’intention droite, service caritatif auprès des plus pauvres, combat pour la justice sociale, témoignage missionnaire, vie consacrée, militantisme écologique enraciné dans la théologie de la création. L’important n’est pas tant la forme particulière de l’engagement que sa motivation profonde : tout faire pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Le Shema nous invite à une radicalité évangélique qui refuse les tiédeurs, les compromis, les demi-mesures. Jésus reprendra cet appel dans des paroles terribles : « Nul ne peut servir deux maîtres. » « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi. » « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. » Ces exigences extrêmes ne sont pas du masochisme spirituel, mais l’expression logique du premier commandement : si Dieu est vraiment unique, si l’aimer doit mobiliser tout notre être, alors aucune concurrence ne peut être tolérée, aucun partage de notre allégeance n’est acceptable.
Pourtant, cette radicalité n’est pas un fardeau écrasant, mais un joug léger. Car l’amour de Dieu n’est pas d’abord notre effort vers lui, mais sa grâce en nous. « Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés », écrit saint Jean. L’amour total que le Shema commande devient possible parce que Dieu lui-même se donne à nous dans le Christ, versant en nos cœurs par l’Esprit Saint la capacité même de l’aimer. Notre réponse d’amour n’est que l’écho reconnaissant de son amour premier.
En ce sens, le Shema trouve son accomplissement plénier dans le mystère pascal. Jésus a aimé le Père de tout son cœur, obéissant jusqu’à la mort de la croix. Il a aimé de toute son âme, offrant sa vie en sacrifice pour le salut du monde. Il a aimé de toute sa force, mobilisant chaque instant de son existence terrestre pour révéler le Père et accomplir sa volonté. En lui, l’humanité a enfin répondu parfaitement à l’appel du Shema. Et parce qu’il nous unit à lui par la foi et les sacrements, sa réponse parfaite devient la nôtre. Nous pouvons aimer Dieu totalement non par nos propres forces, mais en nous laissant habiter par le Christ qui vit en nous.
Que le Shema résonne donc comme un appel joyeux à l’unification de notre être dispersé, à la cohérence entre foi et vie, à l’engagement radical envers le Dieu unique qui nous a aimés le premier. Puisse cette parole millénaire traverser notre modernité désorientée comme une boussole indiquant l’unique direction qui mène à la vie véritable : l’amour de Dieu, source et fin de toute existence humaine.

Pratique : Sept repères pour vivre le Shema au quotidien
- Rituel du matin et du soir : Récitez le Shema au réveil pour consacrer la journée à Dieu, et avant de dormir pour la lui offrir en action de grâce, créant ainsi un rythme spirituel quotidien qui structure votre relation à Dieu.
- Examen de conscience focalisé : Chaque soir, interrogez-vous spécifiquement sur l’une des trois dimensions de l’amour de Dieu (cœur, âme, force) en identifiant un moment où vous l’avez vécu concrètement et un moment où vous avez failli.
- Mémorisation méditative : Apprenez le Shema par cœur en hébreu et dans votre langue, puis ruminez-le lentement dans les temps morts de la journée, laissant chaque mot pénétrer votre conscience et transformer votre regard.
- Jeûne des idoles modernes : Identifiez une réalité qui tend à prendre la place de Dieu dans votre vie (écran, travail, reconnaissance sociale) et pratiquez périodiquement un jeûne de cette idole pour vérifier votre liberté intérieure.
- Service concret hebdomadaire : Engagez-vous dans une action caritative, catéchétique ou communautaire régulière où vous mettez concrètement votre force au service du Royaume, traduisant l’amour de Dieu en amour effectif du prochain.
- Partage familial ou communautaire : Instituez un moment régulier où vous partagez en famille ou entre amis comment vous avez expérimenté l’amour de Dieu pendant la semaine, créant ainsi une mémoire commune de sa présence active.
- Décisions en référence à Dieu : Avant toute décision importante (professionnelle, financière, relationnelle), interrogez-vous explicitement : ce choix manifeste-t-il mon amour de Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force, ou sert-il d’autres priorités idolâtriques ?
Références et sources pour approfondir
Textes bibliques fondamentaux : Deutéronome 6,1-9 (contexte immédiat du Shema) ; Deutéronome 5 (le Décalogue précédant le Shema) ; Marc 12,28-34 (Jésus cite le Shema comme le premier commandement) ; Matthieu 22,34-40 et Luc 10,25-28 (parallèles synoptiques) ; Jean 14,15-24 (l’amour de Dieu manifesté dans l’obéissance aux commandements).
Tradition patristique : Saint Augustin, Commentaire sur l’Évangile de Jean, notamment les traités sur le commandement de l’amour ; Saint Augustin, La Trinité, pour la théologie de l’amour divin ; Origène, Commentaire sur le Cantique des Cantiques, où l’amour de Dieu est exploré comme relation sponsale.
Théologie médiévale : Thomas d’Aquin, Somme théologique, IIa-IIae, questions 23-27 sur la charité ; Bernard de Clairvaux, Traité de l’amour de Dieu, décrivant les degrés de l’amour ; Guillaume de Saint-Thierry, La nature et la dignité de l’amour, sur l’unification de l’être dans l’amour de Dieu.
Mystique chrétienne : Jean de la Croix, La montée du Carmel et La nuit obscure, sur la purification conduisant à l’union à Dieu ; Thérèse d’Avila, Le Château intérieur, décrivant les demeures de l’âme dans sa progression vers Dieu ; Frère Laurent de la Résurrection, La pratique de la présence de Dieu, pour la spiritualité de l’ordinaire sanctifié.
Tradition juive rabbinique : La Mishna, traité Berakhot, sur les prescriptions concernant la récitation du Shema ; Le Talmud de Babylone, discussions sur l’intention requise pour accomplir le commandement ; Commentaires de Rashi sur le Deutéronome, offrant l’interprétation rabbinique classique.
Études contemporaines : André Neher, L’essence du prophétisme, pour comprendre le monothéisme biblique dans son contexte ; Marc-Alain Ouaknin, Lire aux éclats, sur l’herméneutique juive du Shema ; André Wénin, La Torah racontée, pour une lecture narrative et théologique du Deutéronome ; Joseph Ratzinger (Benoît XVI), Jésus de Nazareth, tome I, chapitre sur le double commandement de l’amour.
Spiritualité pratique : Jacques Philippe, La liberté intérieure, sur la purification du cœur et l’abandon à Dieu ; Timothy Keller, La raison est pour Dieu, pour répondre aux objections contemporaines contre la foi ; Charles de Foucauld, Écrits spirituels, témoignage d’une vie totalement donnée à Dieu par amour.


