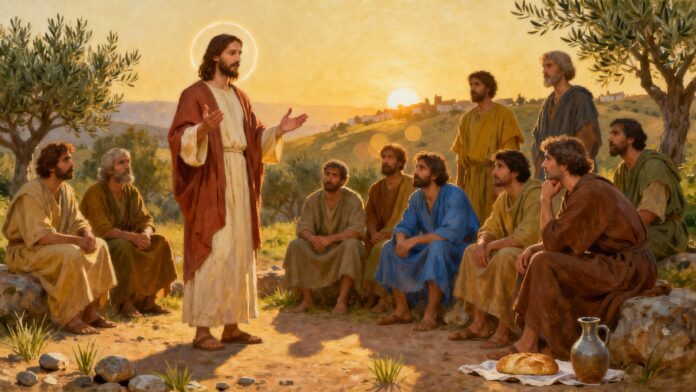Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Vous le savez :
ceux que l’on regarde comme chefs des nations
les commandent en maîtres ;
les grands leur font sentir leur pouvoir.
Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi.
Celui qui veut devenir grand parmi vous
sera votre serviteur.
Celui qui veut être parmi vous le premier
sera l’esclave de tous :
car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir,
et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
Servir pour régner : accueillir le don du Fils de l’homme
Comment Marc 10,42‑45 transforme notre rapport au pouvoir, à la liberté et à la vie donnée.
On rêve souvent d’un monde guidé par la justice et la bonté, mais le pouvoir garde, même dans les cœurs les plus sincères, un goût d’appropriation. L’Évangile de Marc nous propose un renversement radical : servir, c’est régner ; donner, c’est vivre. Cette parole du Christ — « Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude » — éclaire notre époque blessée par la domination et la recherche de soi. Cet article s’adresse à celles et ceux qui aspirent à une grandeur évangélique, fondée non sur la force mais sur la gratuité du service.
- Contexte : le chemin vers Jérusalem et le malentendu du pouvoir.
- Analyse : le service comme cœur de la royauté messianique.
- Déploiement : trois axes de transformation — autorité, liberté, alliance.
- Applications : société, communauté, intimité.
- Résonances : traditions chrétiennes et voix patristiques.
- Pistes de pratique et prière liturgique.
- Défis contemporains et conclusion active.
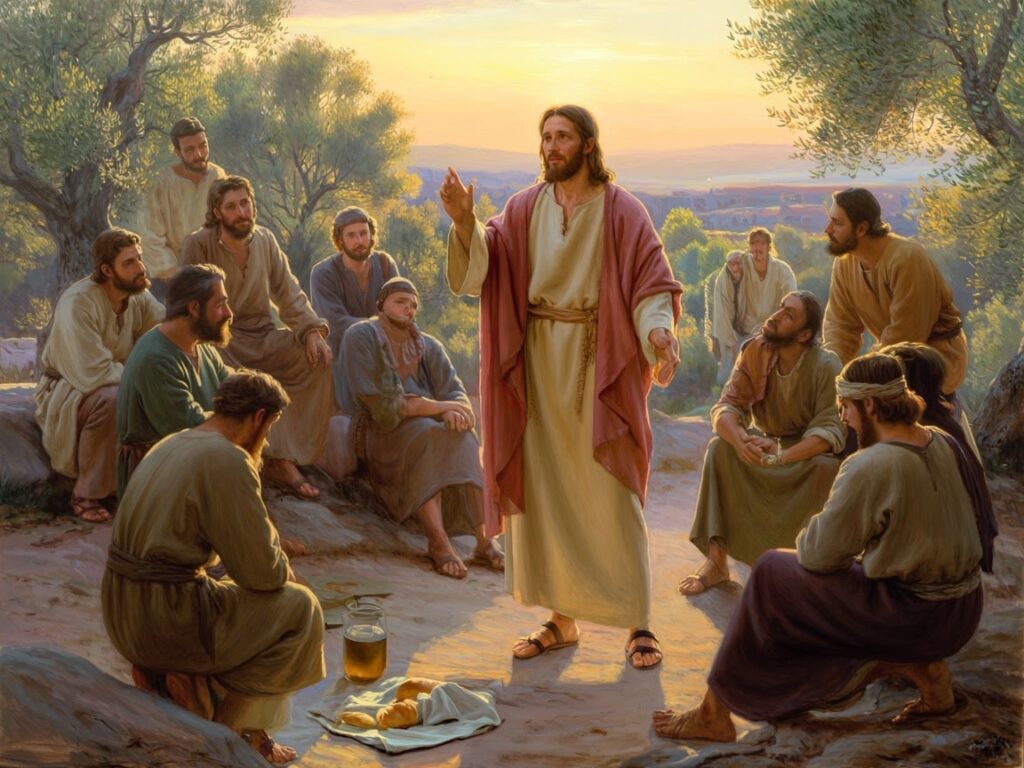
Contexte
Nous sommes dans la seconde partie de l’Évangile selon Marc, au moment où Jésus monte vers Jérusalem. La tension dramatique atteint son apogée : il a annoncé sa passion à trois reprises, et ses disciples peinent à comprendre ce que signifie suivre un Messie souffrant. C’est dans ce contexte de confusion, après la demande ambitieuse de Jacques et Jean pour « siéger à sa droite et à sa gauche », que Jésus prononce ce discours décisif sur le service.
Les peuples de l’Antiquité étaient habitués à des modèles verticaux : rois, prêtres, chefs de guerre imposaient leur autorité. L’empire romain glorifiait la puissance et la hiérarchie. Jésus, au contraire, propose une révolution silencieuse : la grandeur n’est plus dans la domination mais dans le don de soi. La formule « en rançon pour la multitude » fait résonner l’image du serviteur d’Isaïe — « il s’est livré lui-même jusqu’à la mort ». Ici, le pouvoir devient oblation, la gloire devient service.
Le mot « rançon » (lutron) évoque la libération d’un captif au prix d’un paiement. Jésus ne décrit pas une transaction économique, mais la remise totale de sa vie comme prix de libération pour l’humanité esclave du péché et de l’égoïsme. Par ce geste, il redéfinit le sens du leadership : l’autorité se fait service, la première place s’identifie à la dernière.
Marc, toujours attentif à l’action plus qu’au discours, met ici en lumière l’unité entre la mission et le témoignage. Jésus ne prêche pas la servitude ; il montre que le service est la forme suprême de liberté, parce qu’il naît de l’amour. Il replace la structure communautaire sur une base relationnelle : non la compétition, mais la communion dans le don mutuel.
Cette parole, prononcée en chemin, éclaire aussi notre marche. Le christianisme n’est pas un système d’idées mais une manière de vivre en suivant le Serviteur‑Roi. Loin d’être une faiblesse, le service devient le lieu d’une victoire cachée, celle qui renverse toutes les logiques de pouvoir.
Analyse
Le texte de Marc 10,42‑45 bouleverse profondément les cadres humains de réussite et de domination. Jésus identifie le modèle du monde — « les chefs commandent en maîtres » — pour mieux en renverser la logique. Ce n’est pas une simple invitation morale : c’est un déplacement de perspective, une métamorphose du pouvoir.
La clé du passage réside dans le double contraste entre « servir » et « être servi », entre « donner sa vie » et « la préserver ». Jésus fait de sa propre existence l’illustration du principe qu’il enseigne : la grandeur n’est pas dans la possession mais dans le don. En se définissant comme « Fils de l’homme » venu pour servir, il embrasse la condition humaine et révèle sa dignité ultime : celle d’un être capable de se livrer par amour.
Le verbe « donner » traduit l’acte fondateur de la révélation chrétienne. Le don n’est pas conséquence d’un échec, ni un sacrifice subi ; il est initiative de liberté. En ce sens, la « rançon » évoque moins la dette que la libération : Jésus délivre la multitude de la captivité du soi centré. Ainsi, le pouvoir authentique devient service libérateur.
Cette parole se situe aussi dans la tension entre l’attente messianique et la croix. Pour les disciples, le règne de Dieu signifiait un triomphe visible ; pour Jésus, il s’agit d’un rayonnement invisible qui transforme les cœurs. Le renversement opéré ici prépare la dernière Cène, où le geste du lavement des pieds viendra incarner ce discours. Le Christ y montre que le service n’est pas la tâche de quelques‑uns, mais la vocation de tous.
Enfin, Marc fait entendre dans ce passage une note ecclésiale. Les communautés chrétiennes naissantes avaient besoin d’être purifiées du désir de domination. Cette parole devient fondement d’une éthique chrétienne du pouvoir : toute autorité vient de Dieu pour le bien des autres, et non pour elle‑même.
Ainsi, cette scène n’est pas un simple épisode moral, mais le pivot théologique de l’Évangile de Marc : le Fils de l’homme manifeste sa royauté dans l’humilité, son autorité dans la compassion, et sa puissance dans la faiblesse assumée.
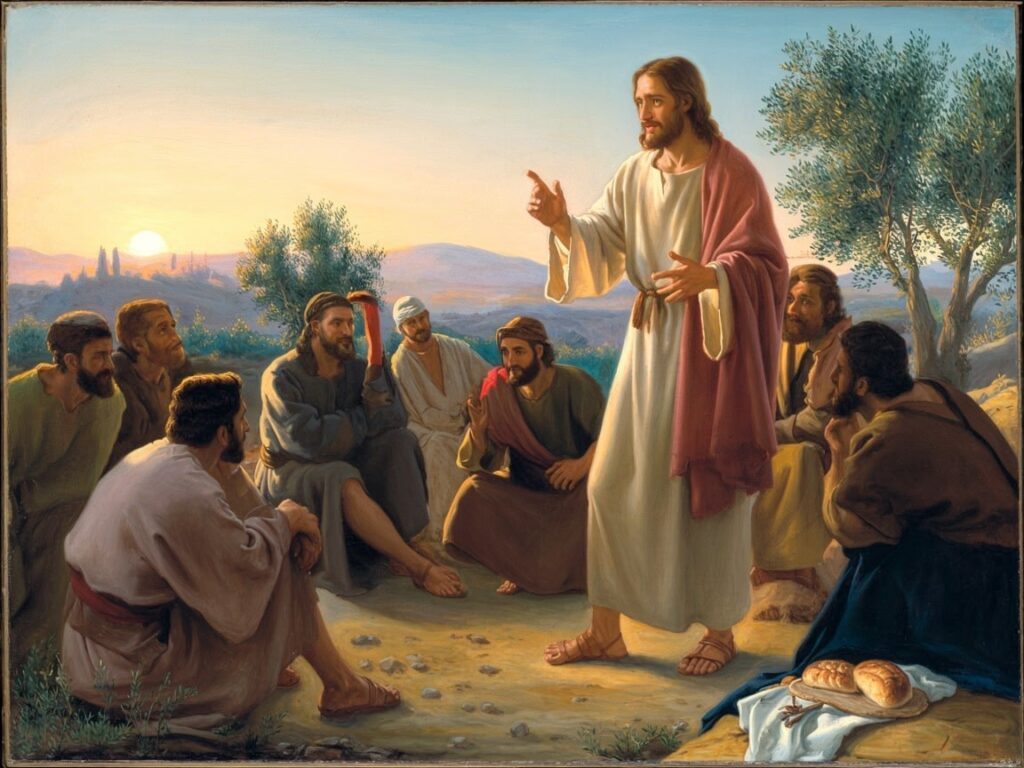
Le pouvoir transformé : autorité qui élève
Tout système humain produit des hiérarchies. L’enjeu n’est pas d’y échapper, mais de les purifier. Jésus ne nie pas l’autorité ; il la convertit. Être « le premier », désormais, signifie faire grandir les autres. Le modèle devient celui du pédagogue qui soutient, du parent qui accompagne, du responsable qui fait confiance.
Dans la tradition chrétienne, cette autorité s’enracine dans la kenosis — l’abaissement volontaire du Christ. Ce mouvement descend pour mieux élever, à l’image du lavement des pieds : le Maître s’agenouille pour manifester qu’aimer, c’est se mettre à hauteur d’autrui. Ce geste fonde toute éthique du leadership chrétien : gouverner, c’est se mettre au service de la croissance de ceux qu’on conduit.
Aujourd’hui encore, cette inversion reste révolutionnaire. Les institutions, les entreprises, les familles peuvent en recevoir un souffle neuf. Le « management par le service » n’est pas une stratégie commerciale, mais une anthropologie de la responsabilité.
La liberté accomplie : se donner sans se perdre
Le mot « rançon » traduit une liberté gagnée, et non perdue. Jésus ne subit pas ; il choisit. Dans son acte de don, il nous révèle que la liberté véritable ne réside pas dans l’indépendance, mais dans la communion. On ne devient pas pleinement soi contre les autres, mais pour eux.
Cette dynamique traverse la vie spirituelle : celui qui donne découvre la joie de ne plus être le centre. Il s’ouvre à la circulation de la grâce, où recevoir et offrir ne s’opposent plus. Le service du Christ devient ainsi une école de dépossession heureuse. À travers lui, chacun apprend à aimer sans calcul, à offrir sans attendre, à vivre l’humilité non comme dévalorisation mais comme vérité intérieure.
Cette perspective éclaire nos crises contemporaines : burnout professionnel, compétition sociale, narcissisme numérique. Chacun veut exister, être reconnu, mais Jésus nous invite à exister en donnant — condition paradoxalement plus stable que celle de la performance perpétuelle.
L’alliance accomplie : rançon et multitude
Enfin, la formule « pour la multitude » inscrit la Pâque du Christ dans le cadre de l’alliance biblique. Le serviteur souffrant d’Isaïe portait les fautes de « la multitude » ; Jésus s’y identifie pleinement. La rançon est un acte d’alliance, non une opération comptable. Elle scelle dans son sang la réconciliation du ciel et de la terre.
Dans la logique biblique, la rançon rétablit la communion rompue. Le Christ assume en lui l’histoire blessée des hommes pour la réorienter vers le Père. Le service n’est donc pas seulement un comportement moral, mais une œuvre de salut. C’est pourquoi il devient participation : servir avec le Christ, c’est coopérer à la libération de l’humanité tout entière.
Cette dimension ouvre la spiritualité du service à une dimension mystique : chacun, dans la mesure de son choix de servir, entre dans le mouvement rédempteur du Christ.

Implications
L’enseignement du Christ sur le service concerne toutes les dimensions de la vie.
Dans la société, il invite à repenser la notion de pouvoir. La politique, l’économie, l’éducation peuvent être des lieux de service. L’autorité devient juste quand elle protège la dignité, quand elle cherche le bien commun plutôt que l’avantage personnel. L’acte de diriger peut être sanctifié s’il est traversé par le souci de l’autre.
Dans la communauté chrétienne, le passage de Marc fonde la diaconie. Le ministère du service n’est pas marginal ; il exprime la nature de l’Église. Chaque baptisé, dans son rôle, participe à la mission du Christ Serviteur : nourrir, enseigner, écouter, guérir, visiter. C’est par ces gestes humbles que le Royaume s’étend silencieusement.
Dans la vie personnelle, enfin, ce texte appelle chacun à relire ses relations : suis‑je au service des autres ou de mes désirs ? Le don quotidien — un temps offert, une écoute, un pardon — devient l’exercice pratique du mystère de la rançon. Donner sa vie n’est pas réservé aux héros, mais se réalise dans la fidélité aux petits gestes.
Ainsi, servir revient à humaniser. C’est passer d’une logique de possession à une logique de compassion, en portant autrui comme un frère. Cette conversion demande de la lucidité et du courage, mais elle transforme la vie intérieure : là où je sers, je deviens libre.
Résonances traditionnelles
Les Pères de l’Église ont abondamment commenté ce passage. Saint Augustin voit dans le service du Christ le résumé de toute la charité divine : Dieu s’abaisse pour que l’homme se relève. Pour lui, la rançon n’est pas le prix versé au diable, mais l’amour qui libère. La grandeur divine s’exprime par la descente volontaire.
Saint Jean Chrysostome souligne que le Christ n’a pas seulement ordonné de servir, mais qu’il a vécu jusque dans sa chair le service. Il le qualifie de “Médicament contre l’orgueil humain”. Grégoire le Grand, quant à lui, affirme que “plus on s’élève dans la charge, plus on doit s’abaisser dans l’humilité.” Ce principe fonde toute notion chrétienne de responsabilité.
Dans la liturgie, cette parole de Jésus inspire directement les offices du Jeudi Saint et du Dimanche du Serviteur. Elle structure aussi la prière eucharistique : “pris, béni, rompu, donné”. Chaque messe en redit le sens : “Ceci est mon corps livré pour vous.” Cette résonance montre combien le service et le don sont le langage même de Dieu.
Les ordres religieux, du diaconat permanent aux congrégations hospitalières, incarnent cette logique. François d’Assise, Vincent de Paul, Mère Teresa ont traduit dans le concret la parole de Marc. Leur vie manifeste que la grandeur spirituelle s’éprouve toujours dans la proximité des plus vulnérables.

Pistes de méditation
- Lire lentement le passage de Marc 10,42‑45, en imaginant la scène.
- Visualiser les deux attitudes : dominer ou servir.
- Demander : “Seigneur, apprends‑moi à servir avec joie.”
- Identifier chaque jour un geste concret de service gratuit.
- Offrir une prière silencieuse pour ceux qui exercent le pouvoir.
- Méditer le Christ au lavement des pieds.
- Revenir à la paix intérieure qui naît du don.
Ces quelques étapes redonnent un rythme spirituel simple. La méditation du service fait naître la gratitude et la liberté intérieure : servir, ce n’est pas se diminuer ; c’est entrer dans la bienveillance divine.
Défis contemporains
Comment vivre cet idéal dans un monde où la rivalité, la performance et la fracture sociale dominent ? Le premier danger est l’inversion de mots : on “sert” parfois pour être applaudi, ou pour garder le contrôle moral. Le Christ, lui, sert sans attendre de retour. Le second défi est structurel : nos institutions valorisent la réussite visible ; le service s’oublie derrière la communication.
Pour répondre à cela, il ne s’agit pas de fuir le monde, mais d’en changer la logique. Dans une entreprise, le service peut se manifester par la coopération plutôt que la compétition. Dans la politique, par le souci concret des plus faibles. Dans la vie spirituelle, par l’acceptation de l’humilité. Le service n’est pas une moralisation douce, c’est une puissance de transformation intérieur.
Autre défi : ne pas confondre service et servitude. Servir librement, c’est aimer ; se soumettre passivement, c’est fuir sa dignité. Jésus ne demande pas de s’écraser, mais d’aimer jusqu’au bout. Sa rançon n’est pas une humiliation, mais un acte souverain. Chaque chrétien est donc appelé à un équilibre : humilité du cœur et fermeté de la conscience.
Le monde d’aujourd’hui a besoin de figures de service lumineux : éducateurs, bénévoles, médecins, artisans du soin, parents, responsables fraternels. Ils témoignent que la vraie grandeur demeure possible, même dans un univers saturé de pouvoir.
Prière
Seigneur Jésus,
Toi qui es venu non pour être servi, mais pour servir,
fais descendre sur nos cœurs l’esprit de ton humilité.
Quand nous cherchons la première place, rappelle‑nous le geste du serviteur.
Quand nous voulons être admirés, tourne notre regard vers la croix.
Quand nous craignons de nous perdre en donnant, fais‑nous découvrir la joie du vrai don.
Apprends‑nous que servir, c’est participer à ton œuvre de salut.
Que nos paroles soient douces, que nos gestes soient attentifs,
que nos responsabilités deviennent des occasions d’aimer.
Donne‑nous de porter les fardeaux les uns des autres
comme toi as porté la croix du monde.
Toi, rançon offerte pour la multitude,
transforme nos vies en offrandes vivantes.
Apprends‑nous à régner par la bonté,
à gouverner par la miséricorde,
et à triompher par la patience.
Que ton Esprit nous unisse dans l’Église
comme dans la cité des hommes,
pour bâtir un royaume d’amour et de service.
Amen.
Conclusion
Le verset de Marc 10,42‑45 résume l’Évangile : la grandeur passe par le service, la vie s’accomplit dans le don. Chaque époque doit redécouvrir ce secret, car l’égoïsme se renouvelle sans fin. Mais la Parole demeure neuve : “Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir.”
Accueillir cette parole, c’est changer de centre : apprendre à regarder les autres comme des trésors confiés, non comme des obstacles. C’est aussi faire de nos responsabilités des lieux de communion. Là où le service est vécu, Dieu habite.
Que chacun reparte avec une certitude simple : rien ne se perd du don. La rançon payée par le Christ est un acte d’amour si vaste que notre propre vie, offerte à notre mesure, devient participation à son œuvre. C’est ce que le monde attend : des serviteurs joyeux, libres et créatifs.
Pratique
- Lire Marc 10,42‑45 au moins une fois par semaine.
- Écrire une phrase résumant ce que “servir” signifie pour vous.
- Choisir un service discret à accomplir chaque jour.
- Remercier une autorité qui exerce un pouvoir juste.
- Examiner sa manière de parler du pouvoir et du succès.
- Prier pour les dirigeants afin qu’ils deviennent serviteurs.
- Relire sa journée en cherchant les gestes de don.
Références
- Évangile selon saint Marc, 10,42‑45.
- Isaïe 53 : le Serviteur souffrant.
- Saint Augustin, Contra Faustum, XXII.
- Jean Chrysostome, Homélies sur Matthieu.
- Grégoire le Grand, Règle pastorale.
- François d’Assise, Admonitions.
- Concile Vatican II, Lumen gentium, chap. II.
- Pape François, Evangelii Gaudium (2013).