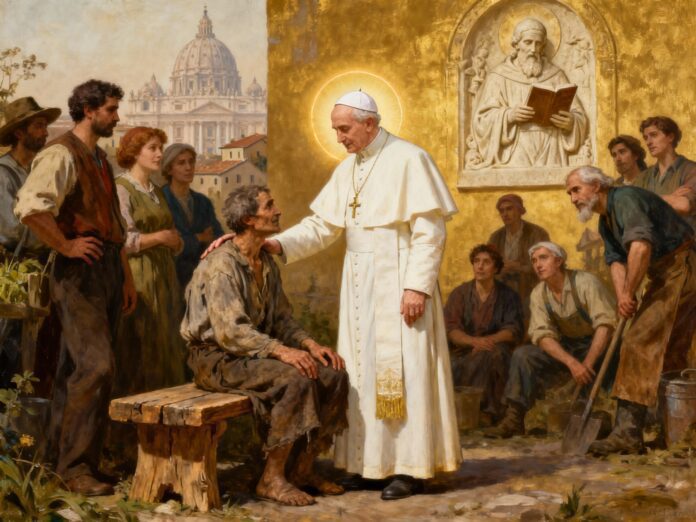En s’appuyant sur les Pères de l’Église, le pape défend une lecture exigeante, mais classique de la pauvreté. Chaque samedi, l’envoyé spécial permanent de La Croix au Vatican vous emmène dans les coulisses du plus petit État du monde.
Encore une référence à saint Augustin. Dans son discours aux mouvements populaires, prononcé le jeudi 23 octobre au Vatican, Léon XIV paraphrase à nouveau le Père de l’Église. Cette répétition n’est pas anodine. Depuis son élection en mai dernier, le premier pape américain de l’histoire n’a cessé d’invoquer l’évêque d’Hippone, son auteur de prédilection. Cette fois, la citation touche au cœur même de son projet pontifical : la question de la pauvreté.
« Selon Augustin, dit le pape, l’humain est au centre d’une éthique de responsabilité. Il nous enseigne que la responsabilité, surtout envers les pauvres et ceux qui ont des besoins matériels, naît du fait d’être humain avec ses semblables. » Cette phrase, prononcée devant des représentants de communautés défavorisées du monde entier, éclaire d’une lumière particulière la manière dont Léon XIV entend conduire l’Église.
Cinq mois après son élection, le pape américain commence à tisser les fils d’une pensée cohérente, ancrée dans la tradition patristique mais résolument tournée vers les urgences contemporaines. Sa référence constante à saint Augustin n’est pas qu’un ornement intellectuel : elle structure une vision de l’Église et de son rapport aux plus vulnérables.
Saint Augustin, compagnon de route du pontificat
Un dialogue ininterrompu avec l’évêque d’Hippone
Depuis sa première apparition à la loggia de Saint-Pierre, le soir du 8 mai, Léon XIV multiplie les références à saint Augustin. Lors du Jubilé des jeunes début août, à Tor Vergata, son discours était « tissé, comme souvent, de citations de saint Augustin, son auteur préféré », selon les observateurs présents. Cette proximité avec le docteur de l’Église ne date pas d’hier.
Durant ses années de formation, puis comme évêque missionnaire au Pérou, Robert Prevost – devenu Léon XIV – n’a cessé de méditer les œuvres du Père de l’Église. Les Confessions, La Cité de Dieu, les innombrables sermons d’Augustin ont accompagné sa réflexion théologique et pastorale. « Pour Léon XIV, Augustin n’est pas une référence académique, confie un proche du pontife. C’est un compagnon spirituel, quelqu’un avec qui il dialogue constamment. »
Cette familiarité transparaît dans sa manière de citer l’évêque d’Hippone. Le pape ne se contente pas de reprendre des formules célèbres : il paraphrase, recontextualise, actualise la pensée augustinienne. C’est visible dans son discours du 23 octobre, où la citation ne vient pas comme une caution d’autorité mais comme le prolongement naturel d’une réflexion personnelle.
La citation du 23 octobre : responsabilité et pauvreté
Le passage du discours aux mouvements populaires mérite qu’on s’y arrête. En affirmant que « la responsabilité, surtout envers les pauvres et ceux qui ont des besoins matériels, naît du fait d’être humain avec ses semblables », Léon XIV mobilise une dimension souvent oubliée de la pensée augustinienne : l’anthropologie sociale.
Pour Augustin, l’être humain n’est jamais un individu isolé. Il est toujours déjà en relation, inscrit dans un réseau de responsabilités mutuelles. Cette vision, le pape l’applique directement à la question de la pauvreté. Notre responsabilité envers les pauvres ne découle pas d’abord d’un commandement moral extérieur, mais de notre commune humanité. C’est parce que nous partageons la même condition humaine que nous sommes responsables les uns des autres.
Cette lecture d’Augustin n’est pas neutre. Elle permet à Léon XIV de dépasser le cadre de la charité volontaire pour poser les bases d’une éthique de la justice sociale. Si la responsabilité envers les pauvres découle de notre humanité partagée, elle n’est pas facultative : elle est constitutive de ce que signifie être pleinement humain.
La vision augustinienne de la pauvreté
Une lecture exigeante de l’Évangile
Dans son exhortation apostolique Dilexi te, publiée le 9 octobre, Léon XIV « fait de la charité envers les pauvres le critère de vérité du catholicisme ». Cette formulation radicale s’enracine dans une tradition patristique solide, dont Augustin est l’un des principaux représentants.
Pour l’évêque d’Hippone, la relation aux pauvres n’est pas un aspect secondaire de la vie chrétienne. Elle en constitue le test décisif. Dans ses sermons, Augustin n’hésite pas à affirmer que le chrétien qui néglige le pauvre se coupe de l’Évangile lui-même. « Tu veux prier Dieu ? Donne d’abord au pauvre », proclame-t-il dans un de ses sermons les plus célèbres.
Cette radicalité, Léon XIV la reprend à son compte. Dans Dilexi te, il « durcit le ton : oublier ou mépriser les pauvres ne relève pas de la simple indifférence morale, mais d’une rupture avec l’Évangile ». Le vocabulaire est fort : on n’est plus dans le registre de la recommandation, mais dans celui de l’essence même de la foi chrétienne.
Cette lecture exigeante de l’Évangile s’inscrit dans ce que le pape appelle une défense contre les « hérésies contemporaines ». Sans les nommer explicitement, il vise ces formes de christianisme qui évacuent la dimension sociale de la foi pour la réduire à une piété individualiste ou à un système de normes morales déconnectées de la justice concrète.
Le pauvre comme visage du Christ
La théologie augustinienne de la pauvreté repose sur une intuition fondamentale : dans le pauvre, c’est le Christ lui-même qui se présente à nous. Cette identification, déjà présente dans l’Évangile de Matthieu (« J’avais faim et vous m’avez donné à manger »), Augustin la développe avec une force particulière.
Pour l’évêque d’Hippone, le pauvre n’est pas simplement l’objet de notre charité. Il est le sacrement vivant du Christ. En le servant, ce n’est pas une bonne action que nous accomplissons : c’est le Seigneur lui-même que nous rencontrons. « Le Christ mendie à ta porte dans le pauvre », écrit Augustin dans un de ses sermons.
Cette perspective transforme radicalement le rapport à la pauvreté. Il ne s’agit plus de « faire quelque chose pour les pauvres » de manière descendante, mais de reconnaître en eux une présence sacrée qui nous interpelle et nous transforme. C’est exactement ce que Léon XIV exprime quand il affirme, dans son discours du 23 octobre, que « la terre, le logement et le travail sont des droits sacrés ».
L’adjectif « sacré » n’est pas anodin. Il situe ces réalités matérielles dans l’ordre de ce qui touche au divin. Refuser à quelqu’un un toit ou un travail, ce n’est pas seulement commettre une injustice sociale : c’est porter atteinte à quelque chose de sacré, à la dignité humaine qui porte en elle une dimension transcendante.
Léon XIV et l’héritage de François
« Dilexi te » : continuité et approfondissement
L’exhortation apostolique Dilexi te (« Je t’ai aimé ») marque un moment clé du jeune pontificat. Publiée cinq mois après l’élection, elle « inscrit son pontificat dans la continuité de son prédécesseur, le pape François : une Église proche des pauvres ».
Cette continuité est assumée, revendiquée même. Léon XIV ne cherche pas à prendre ses distances avec François, dont il a hérité de nombreux chantiers. Au contraire, il s’emploie à « institutionnaliser François », comme le note un observateur du Vatican. Mais cette continuité n’est pas répétition mécanique : elle passe par un approfondissement doctrinal.
Là où François parlait avec le cœur, multipliant les gestes prophétiques et les formules percutantes, Léon XIV s’appuie sur la tradition patristique pour donner à l’option préférentielle pour les pauvres une assise théologique solide. Saint Augustin devient l’outil intellectuel qui permet de montrer que cette option n’est pas une innovation du XXe siècle, mais appartient au cœur de la tradition chrétienne la plus ancienne.
Dans Dilexi te, le pape développe une réflexion sur ce qu’il appelle la « nécessité » de l’attention aux pauvres. Ce terme, là encore, n’est pas choisi au hasard. Il ne s’agit pas d’une possibilité parmi d’autres, d’une sensibilité particulière que certains chrétiens pourraient cultiver. C’est une nécessité constitutive de la foi chrétienne elle-même.
Les mouvements populaires, destinataires privilégiés
Le discours du 23 octobre aux mouvements populaires s’inscrit dans cette dynamique. François avait fait de ces organisations de base – qui luttent pour l’accès à la terre, au logement et au travail – des interlocuteurs privilégiés. Léon XIV reprend ce dialogue, mais en l’enrichissant d’une dimension doctrinale.
« Le pape Léon XIV a livré un discours puissant aux mouvements populaires, prolongeant l’héritage de François tout en élargissant le combat social de l’Église », note un observateur. Cet élargissement passe par une articulation plus claire entre l’Évangile et les luttes sociales concrètes.
En affirmant que « la terre, le logement et le travail sont des droits sacrés », le pape ne fait pas que reprendre un slogan des mouvements sociaux. Il opère un geste théologique : il inscrit ces revendications matérielles dans l’ordre du sacré, donc de l’intangible. Ces droits ne peuvent être négociés, marchandisés, relativisés, car ils touchent à la dignité humaine elle-même.
Cette sacralisation des droits sociaux fondamentaux est cohérente avec la pensée augustinienne. Pour Augustin, l’ordre social juste n’est pas une simple question d’organisation technique de la société. C’est un reflet, toujours imparfait, de la justice divine. Une société qui tolère que certains soient privés du nécessaire n’est pas simplement une société mal organisée : c’est une société en rupture avec l’ordre voulu par Dieu.
Une éthique de responsabilité
Au-delà de la charité : la justice sociale
La référence augustinienne permet à Léon XIV de dépasser le cadre de la charité traditionnelle pour poser les bases d’une éthique de la responsabilité collective. Cette distinction est cruciale et mérite qu’on s’y attarde.
La charité, dans son acception courante, relève du volontaire. C’est un geste de générosité, louable certes, mais qui reste à la discrétion de chacun. Je peux choisir de donner ou de ne pas donner, d’aider ou de passer mon chemin. La charité n’engage pas ma responsabilité au sens strict : elle manifeste ma bonté éventuelle.
La responsabilité, au contraire, n’est pas facultative. Elle découle de ma condition même d’être humain. En affirmant que « la responsabilité, surtout envers les pauvres, naît du fait d’être humain avec ses semblables », Léon XIV situe notre devoir envers les pauvres non dans l’ordre du mérite moral mais dans celui de la justice.
Cette distinction entre charité et justice n’est pas nouvelle. Elle traverse toute la tradition de la doctrine sociale de l’Église. Mais Léon XIV lui donne une force particulière en la fondant sur l’anthropologie augustinienne. Notre responsabilité envers les pauvres n’est pas une vertu supplémentaire que nous pourrions cultiver : elle est constitutive de notre humanité elle-même.
Les « droits sacrés » selon Léon XIV
Le concept de « droits sacrés » que Léon XIV développe dans son discours du 23 octobre mérite une attention particulière. Il représente une innovation théologique significative, même s’il s’enracine dans la tradition.
En qualifiant de « sacrés » les droits à la terre, au logement et au travail, le pape opère un double geste. D’une part, il retire ces réalités de la sphère purement économique pour les inscrire dans l’ordre du religieux. D’autre part, il affirme que leur violation n’est pas qu’une injustice sociale : c’est une forme de sacrilège.
Cette sacralisation des droits sociaux fondamentaux pourrait sembler excessive. N’est-ce pas instrumentaliser le religieux au service d’un agenda politique ? La réponse de Léon XIV, inscrite dans la logique augustinienne, est claire : ces droits sont sacrés parce qu’ils touchent à la dignité humaine, et la dignité humaine est sacrée parce que l’être humain est créé à l’image de Dieu.
Pour Augustin, et Léon XIV le reprend à son compte, il n’y a pas de séparation étanche entre le spirituel et le matériel. L’être humain n’est pas un pur esprit qui aurait accessoirement un corps : c’est une unité psychosomatique où le corps et l’esprit sont indissociables. Priver quelqu’un du nécessaire matériel, c’est donc porter atteinte à sa dignité spirituelle.
Cette vision intégrale de la personne humaine est au cœur de ce que le pape appelle « une éthique de responsabilité ». Nous ne sommes pas responsables seulement du salut spirituel de nos frères et sœurs : nous sommes responsables de leur bien-être matériel, de leurs conditions de vie concrètes, de leur capacité à mener une existence digne.
Les implications concrètes
Un pontificat marqué par l’option préférentielle pour les pauvres
Cinq mois après son élection, les contours du pontificat de Léon XIV se précisent. « En plaçant les pauvres au cœur de son pontificat et en dénonçant les logiques économiques », le pape américain se situe clairement dans la lignée de François, tout en lui donnant une assise doctrinale plus explicite.
Cette option préférentielle pour les pauvres se manifeste dans les gestes et les discours. La rencontre avec les mouvements populaires, les appels répétés à la justice sociale, l’insistance sur les « droits sacrés » : tout concourt à faire de la question sociale l’un des axes majeurs du pontificat.
Mais cette centralité de la pauvreté n’est pas qu’un choix pastoral. Elle est présentée comme découlant de l’essence même du christianisme. C’est toute la force de la référence augustinienne : elle permet de montrer que l’attention aux pauvres n’est pas une mode passagère ou une sensibilité particulière de tel ou tel pape, mais appartient au patrimoine doctrinal permanent de l’Église.
Dans Dilexi te, Léon XIV va jusqu’à affirmer que « oublier ou mépriser les pauvres » constitue « une rupture avec l’Évangile ». Cette formulation radicale n’est pas sans rappeler les positions d’Augustin, qui n’hésitait pas à dire que le riche qui garde pour lui seul ce dont il n’a pas besoin se rend coupable de vol envers les pauvres.
Les défis contemporains
Cette vision augustinienne de la pauvreté doit aujourd’hui s’affronter à des réalités que l’évêque d’Hippone ne pouvait imaginer : la mondialisation, les inégalités croissantes, les migrations massives, les crises écologiques qui frappent d’abord les plus vulnérables.
Léon XIV en est conscient. Dans son discours aux mouvements populaires, il ne se contente pas de rappels doctrinaux : il « dénonce les logiques économiques » qui produisent l’exclusion. Cette dénonciation s’inscrit dans la tradition prophétique de l’Église, mais elle prend aujourd’hui une acuité particulière.
Le pape est lucide sur les limites de son action. Dans sa première interview, publiée en septembre, il confiait se trouver encore en « apprentissage », notamment dans son rôle de « chef d’État à l’échelle mondiale ». Cette humilité n’empêche pas la fermeté. En affirmant que « la terre, le logement et le travail sont des droits sacrés », il pose un principe non négociable qui doit servir de boussole aux politiques publiques.
Cette posture est cohérente avec la pensée augustinienne. Pour Augustin, l’Église n’a pas vocation à diriger la cité terrestre, mais elle a le devoir de rappeler les principes de justice qui doivent l’animer. Le rôle du pape n’est pas de proposer des solutions techniques aux problèmes économiques, mais de poser les bases éthiques à partir desquelles ces solutions doivent être pensées.
Une lecture classique et exigeante
Enracinement dans la tradition
La démarche de Léon XIV présente une caractéristique remarquable : elle est à la fois radicale dans ses conclusions et profondément traditionnelle dans ses fondements. En s’appuyant sur saint Augustin, le pape montre que l’attention exigeante aux pauvres n’est pas une invention de la théologie de la libération ou une concession à l’air du temps : elle appartient au cœur de la tradition patristique.
Cette stratégie intellectuelle n’est pas innocente. Dans une Église où certains voient dans l’option préférentielle pour les pauvres une dérive idéologique, Léon XIV répond en montrant que c’est au contraire le mépris des pauvres qui constitue une innovation hérétique. « Face aux hérésies contemporaines », écrit-il dans Dilexi te, l’attention aux pauvres apparaît comme le critère de l’orthodoxie véritable.
Cette manière de faire dialoguer tradition et urgences contemporaines caractérise le style du nouveau pape. Formé intellectuellement dans la tradition, il ne cherche pas la rupture pour la rupture. Mais il ne se contente pas non plus d’un traditionalisme figé. Il actualise les sources, les fait parler aux questions d’aujourd’hui.
Une exigence qui dérange
La référence à Augustin permet à Léon XIV de tenir une ligne exigeante sans paraître révolutionnaire. Quand il affirme que négliger les pauvres constitue « une rupture avec l’Évangile », il ne fait que reprendre, en termes contemporains, ce qu’Augustin disait déjà au Ve siècle.
Cette exigence dérange. Elle remet en question des pratiques bien établies, des arrangements confortables, des formes de christianisme qui évacuent la dimension sociale de la foi. Dans certains milieux ecclésiaux, notamment ceux qui valorisent avant tout la piété traditionnelle et l’orthodoxie doctrinale abstraite, ce rappel insistant de la responsabilité envers les pauvres est mal reçu.
Mais Léon XIV ne cherche pas la confrontation pour elle-même. Sa stratégie est plus subtile : en montrant que l’attention aux pauvres appartient à la tradition la plus classique de l’Église, il rend difficile de la rejeter au nom du traditionalisme. Comment pourrait-on se réclamer d’Augustin tout en ignorant ce qu’il enseigne sur la pauvreté ?
Vers une transformation des mentalités
Un travail de longue haleine
Le pontificat de Léon XIV n’en est qu’à ses débuts. Mais déjà, une ligne directrice se dessine : transformer les mentalités en profondeur sur la question de la pauvreté. Il ne s’agit pas simplement de multiplier les appels à la générosité, mais de changer le regard que les chrétiens portent sur les pauvres et sur leur propre responsabilité.
Cette transformation passe par un travail pédagogique patient. Les références répétées à saint Augustin, le développement doctrinal dans Dilexi te, les discours aux mouvements populaires : tout cela vise à créer progressivement un consensus au sein de l’Église sur l’importance centrale de la question sociale.
Le pape sait qu’il ne peut agir seul. Dans sa rencontre avec les évêques de France en juin, il s’est montré « attentif à plusieurs priorités de l’Église en France, notamment l’écologie et l’essor des catéchumènes ». Cette attention aux Églises locales et à leurs préoccupations spécifiques est caractéristique de son style de gouvernance.
Les résistances prévisibles
Cette insistance sur la responsabilité envers les pauvres ne sera pas sans susciter des résistances. Dans certaines parties de l’Église, notamment en Occident, où le christianisme s’est souvent accommodé avec les structures économiques dominantes, ce discours apparaîtra comme excessif, voire politiquement orienté.
Léon XIV en est conscient. Mais il tient bon sur l’essentiel. En affirmant que les droits à la terre, au logement et au travail sont « sacrés », il pose une limite claire : ces questions ne relèvent pas du débat d’opinion ou des préférences politiques, mais de l’essence même de la foi chrétienne.
Cette fermeté sur les principes s’accompagne d’une certaine souplesse sur les modalités. Le pape ne prétend pas dicter des solutions techniques. Il pose un cadre éthique à l’intérieur duquel les solutions doivent être cherchées. Cette distinction entre principes non négociables et applications concrètes discutables est classique dans la doctrine sociale de l’Église.
Un message pour notre temps
La pertinence d’Augustin aujourd’hui
Pourquoi Augustin parle-t-il encore aujourd’hui, seize siècles après sa mort ? C’est la question que pose implicitement Léon XIV par ses références constantes à l’évêque d’Hippone. La réponse tient sans doute à la profondeur anthropologique de la pensée augustinienne.
Augustin ne se contente pas de formuler des règles morales. Il explore ce que signifie être humain, ce qui nous relie les uns aux autres, ce qui fonde notre responsabilité mutuelle. Ces questions sont intemporelles, même si elles se posent différemment selon les époques.
En mobilisant Augustin sur la question de la pauvreté, Léon XIV effectue un double geste. D’une part, il montre que la tradition chrétienne dispose de ressources intellectuelles puissantes pour penser les enjeux sociaux contemporains. D’autre part, il rappelle que ces enjeux ne sont pas nouveaux : la question de la justice sociale traverse toute l’histoire du christianisme.
Un appel à la cohérence
Au fond, le message de Léon XIV tient en une exigence de cohérence. On ne peut se dire chrétien tout en restant indifférent au sort des pauvres. On ne peut célébrer l’Eucharistie, ce sacrement de la communion, tout en acceptant l’exclusion sociale. On ne peut invoquer le Christ tout en ignorant ceux en qui il se rend présent.
Cette exigence n’est pas nouvelle. Mais elle est formulée avec une clarté et une radicalité qui peuvent surprendre. En affirmant que négliger les pauvres constitue « une rupture avec l’Évangile », le pape ne laisse aucune échappatoire. Il ne s’agit pas d’un conseil évangélique réservé à quelques-uns, mais d’une obligation qui découle de la foi elle-même.
L’appui sur saint Augustin permet de donner à cette exigence une légitimité historique et doctrinale. Ce n’est pas une lubie du pape actuel, c’est l’enseignement constant de l’Église depuis ses origines. Augustin le disait déjà, et avant lui les Pères apostoliques, et avant eux les prophètes d’Israël : la foi qui n’engendre pas la justice n’est qu’apparence.
En ce samedi 25 octobre, alors que Léon XIV poursuit son apprentissage du rôle pontifical, ses références répétées à saint Augustin dessinent les contours d’un pontificat qui entend réconcilier tradition et prophétie, enracinement doctrinal et urgence sociale. La pauvreté n’est pas pour lui un dossier parmi d’autres : elle est le lieu où se vérifie l’authenticité de la foi chrétienne.
Cette lecture exigeante, mais classique, de la pauvreté à travers le prisme augustinien pourrait bien devenir l’une des marques distinctives de ce pontificat. Elle rappelle que l’Église, si elle veut rester fidèle à son identité, ne peut faire l’économie d’une conversion permanente à l’Évangile des pauvres.
Comment serez-vous inspiré par cette vision augustinienne de la responsabilité sociale dans votre propre engagement chrétien?